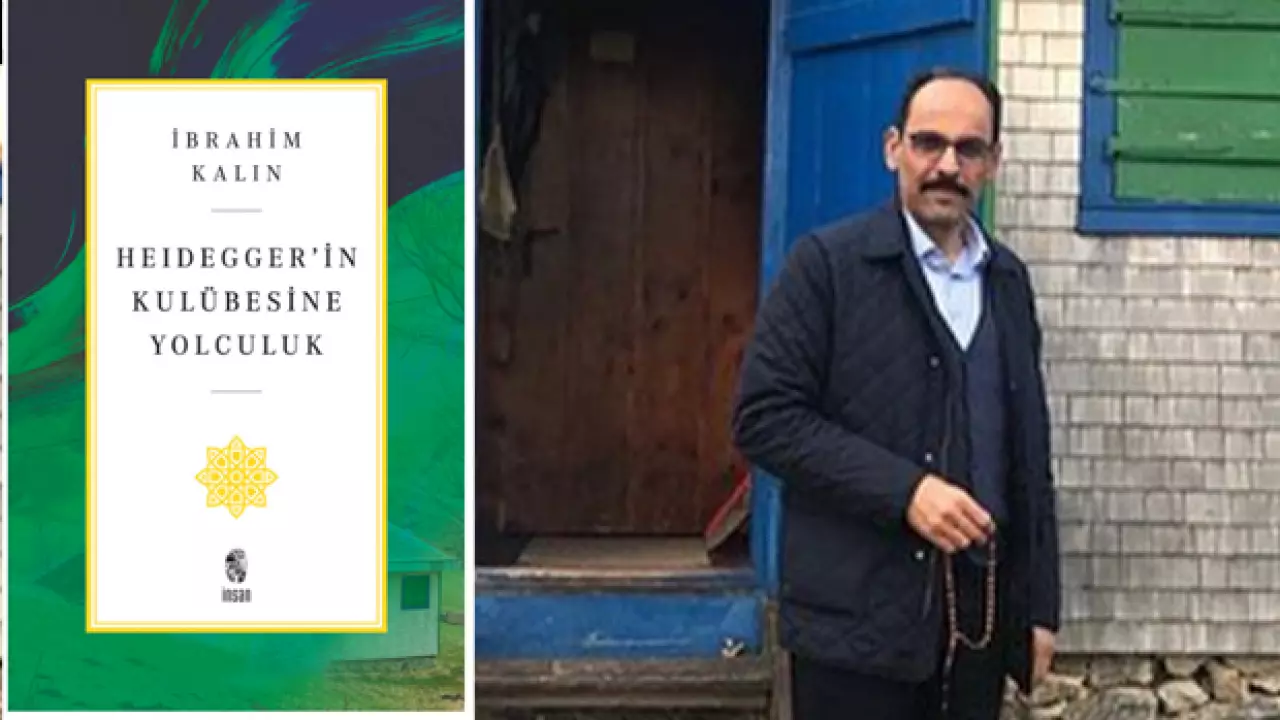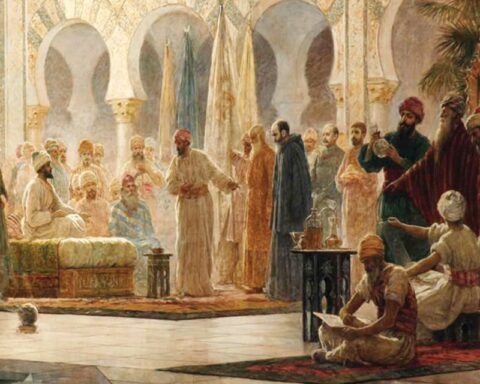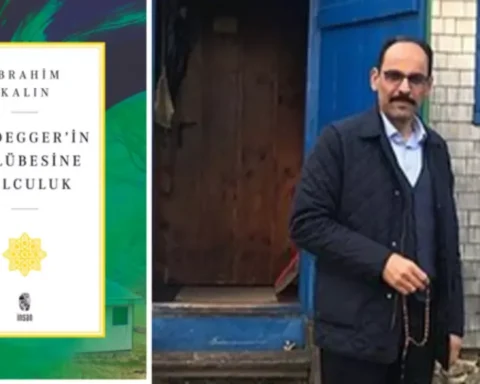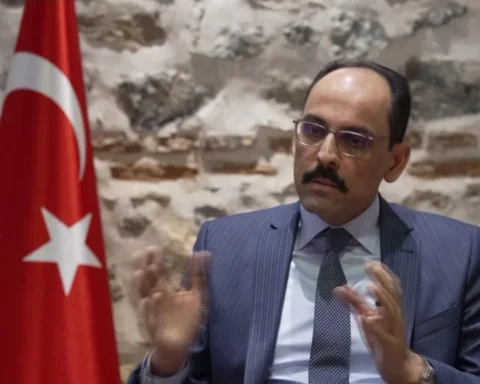La cabane n’est pas le monastère de Heidegger. Ce n’est pas non plus le mausolée d’un saint ou d’un wali. C’est pourquoi il est significatif que Kalın s’éloigne du sens heideggérien de l’Être. D’un côté, cela empêche Kalın de devenir un représentant qui, pensant Heidegger depuis la Turquie, ferait de lui un agent de la réception de Heidegger en Turquie. D’un autre côté, cela ouvre la porte à la question : par quels autres chemins faut-il penser et contempler l’Être ? Penser la cabane de Heidegger non pas seulement en évaluant « son importance dans la vie et la pensée de Heidegger », mais au contraire en recherchant « sa place dans le grand cercle de l’Être », c’est « avoir fait un pas vers le domaine de l’être, du sens et de la vérité » (52). C’est pour cette raison que le livre s’intitule déjà « voyage » : un « voyage » qui, prenant Heidegger pour prétexte, réfléchit sur le concept d’Être. C’est un « voyage » différent de celui qui, chez Heidegger, est « le fleuve ».
—
Si Heidegger n’était pas né à Meßkirch, localité voisine de la Forêt-Noire, proche des frontières de la Suisse et de la France, mais dans une ville côtière, nécessairement catholique , et si, au lieu de la petite hutte qu’il fit construire en 1922 au bord du village de Todtnauberg, dans la Forêt-Noire, où il écrivit la majeure partie de son œuvre, reçut parfois ses collègues, ses amis et ses étudiants, mais où il vécut le plus souvent seul ou avec son épouse, se livrant à de longues promenades sur les sentiers ou pratiquant parfois le ski; s’il avait, disons, fait bâtir une cabane de pêcheur au bord de la mer, et qu’il eût médité sur l’Être comme il le fit dans cette petite hutte de montagne, aurait-il parlé du même Être ?
Cette question m’est venue à l’esprit en lisant les pages du livre Voyage vers la hutte de Heidegger d’Ibrahim Kalın — ouvrage consacré à sa visite en 2019 de la hutte de Heidegger à Todtnauberg (dont l’introduction avait déjà été partiellement publiée auparavant) , notamment celles où il aborde la relation entre l’Être et sa représentation, résumée ainsi : « Ce que nous exprimons à l’aide de mots et de concepts y compris, bien sûr, le mot ou le concept d’Être n’est pas l’Être lui-même, mais sa représentation dans le langage et la pensée » (p. 42). Si Heidegger était né dans un village de pêcheurs et s’était construit, non pas une hutte dans la montagne, mais un abri de pêcheur sur le rivage ou une petite cabane sur une colline surplombant la mer, ses propres écrits sur la hutte (notamment celui intitulé Pourquoi rester en province ?, où il appelle sa hutte « mon monde de travail ») auraient-ils été les mêmes ? Et qu’en serait-il, par exemple, de l’étude d’Adam Sharr (Heidegger’s Hut, traduite en turc par Engin Yurt et publiée en 2016 par Dergâh Yayınları) et des autres travaux cités dans sa bibliographie sur le même sujet ? Si Ibrahim Kalın avait, lui aussi, écrit un livre intitulé Voyage vers l’abri de Heidegger, aurait-il parlé des mêmes choses ?
Heidegger, Kalın et d’autres auteurs ayant écrit sur la hutte s’accordent presque tous à dire que sa vision de la vie rurale a profondément façonné sa pensée de l’Être. D’ailleurs, comme le souligne Kalın dans un chapitre distinct intitulé « Peut-on faire de la philosophie au village ? », Heidegger affirmait que « le travail du paysan » et « le travail du philosophe » proviennent d’une même source. Lorsqu’il écrit : « Lorsqu’une nuit d’hiver, une violente tempête de neige se déchaîne sur la hutte et recouvre tout, c’est là le moment le plus propice à la philosophie », il exprime que le travail du paysan; celui de l’enfant qui risque de glisser en traînant des bûches lourdes, du berger qui, perdu dans ses pensées, pousse son troupeau vers les collines, ou du couple qui prépare d’innombrables poutres pour réparer le toit de leur maison procède du même principe « simple et fondamental » que celui du philosophe. Ce faisant, il manifeste non seulement une attention particulière à la vie rurale, mais aussi aux paysans eux-mêmes, les considérant sous un angle bien différent de celui des citadins qui voient dans la montagne ou la campagne un simple « stimulant » pour l’esprit. Mais si Heidegger n’était pas né dans une bourgade de la Forêt-Noire, mais, disons, sur les rives de la Baltique; par exemple dans un village de pêcheurs catholique proche de Königsberg , aurait-il pu regarder les marins du même œil qu’il regardait les paysans ?
Ces questions, qui posent en réalité la même interrogation sous des formes différentes mais toujours dans le contexte de la représentation, pourraient, à première vue, sembler recevoir à peu près la même réponse. Le pêcheur, lui aussi, « travaille » : lorsqu’il met sa barque à l’eau, qu’il tente de maintenir la barre droite face aux vagues déchaînées, qu’il jette son filet pour capturer le poisson, puis qu’il le remonte, alourdi non seulement par la pêche mais aussi par les débris rejetés par la mer. Et si la hutte de Heidegger s’était trouvée sur la côte d’un village de pêcheurs, son abri aurait sans doute été ébranlé, non par une tempête de neige, mais par le grondement violent des vagues s’écrasant contre le toit, secoué jusqu’à ses fondations. Dans ce cas, Heidegger aurait peut-être considéré ce moment de tempête, lui aussi, comme le moment le plus propice à la philosophie.
Une autre voie d’analyse est également possible. On pourrait, par exemple, à la manière de Carl Schmitt, rappeler que l’être humain est avant tout un être de la terre (Landwesen) : la vie terrestre c’est-à-dire territoriale, en permettant de tracer des frontières et d’organiser de vastes espaces sous un droit enraciné dans le sol, s’oppose à la vie maritime, où l’homme, incapable de délimiter des territoires comme sur terre, doit concevoir la mer comme un espace ouvert. Malgré cette opposition, Schmitt remarque que les Anglais, « bergers de moutons » devenus « enfants de la mer », ont transformé le droit terrestre en une logique de la haute mer, déracinant ainsi le nomos de son ancrage originel. On pourrait, dans cette perspective, observer que Heidegger; bien qu’il ait longuement médité sur le « fleuve », notamment à travers des poèmes de Hölderlin comme “Der Ister” n’a pratiquement jamais pensé à la « mer » (sinon par quelques allusions à la mer Égée via Hölderlin), et relier la question à la différence entre les peuples de la terre et ceux des îles : Britanniques et, à leur suite, Américains, qui ont voulu fonder un nouvel ordre du monde selon la logique de la mer ouverte.
Mais cette hypothèse ne doit pas nous faire oublier qu’à l’époque où les Britanniques étaient encore des « bergers de moutons », Londres n’était qu’un « village de pêcheurs » — et, selon une rumeur, pourrait bien le redevenir un jour. (Comme le rappelle Derrida, analysant chez Fichte, dans ses Discours à la nation allemande, cette tension entre un nationalisme profond et un cosmopolitisme humaniste : le mot Geschlecht qui signifie à la fois sexualité, race, espèce, genre, lignée, famille, génération, ou communauté entretient, du point de vue de « la main de Heidegger » et de « l’oreille de Heidegger », un rapport complexe qu’il convient de penser.)
La véritable question, ici, n’est donc pas celle de savoir si le « nationalisme philosophique » de Heidegger doit être comparé à celui des autres, ni si tout nationalisme, même exprimé philosophiquement, répond toujours à un besoin de concevoir un « chez-soi ». Elle est plutôt celle de savoir comment l’Être peut être pensé et plus encore, comment il peut être représenté.
Comme Heidegger le souligne longuement dans Hölderlin’s Hymn “The Ister” (p. 30), s’il pense le « fleuve » comme un « partir en voyage », ce n’est pas parce qu’il en fait une image poétique ou non poétique du voyage, mais parce que, pour lui, le fleuve est le voyage lui-même. Alors que la pensée chrétienne conçoit souvent le voyage comme l’image d’un parcours allant de la naissance à la mort, donc comme une traversée d’un « monde terrestre » transitoire, pour Heidegger, « le voyage qui est le fleuve » désigne le chemin par lequel les êtres humains viennent habiter cette terre.
Ainsi, « le voyage qui est le fleuve règne », écrit-il, « et cela de manière fondamentale, en appelant à rejoindre le monde la terre comme le sol même de l’être-chez-soi. »
Dans ce sens, il n’est pas possible de parler d’un « voyage de la mer ». La mer n’entretient pas, avec la terre, le lien d’appartenance qui unit le fleuve à son lit ; elle est, au contraire, totalement « ouverte ». Or cette ouverture ne peut pas être pensée comme celle dans laquelle l’Être se manifeste : l’ouverture de la mer est uniforme, indifférenciée. Il n’existe pas, entre la mer et l’existence humaine, de rapport qui puisse fonder une pensée de l’Être. Le fleuve, à la fois lui-même et son propre voyage, trouve son essence comme l’être humain dans la recherche de son sol : il découvre son ouverture en demeurant enraciné, et c’est ainsi qu’il atteint à une forme de rencontre. De manière singulière, la pensée heideggérienne du « fleuve » s’interrompt avant que celui-ci ne rejoigne la mer, avant que le fleuve ne s’unisse à la mer. L’« ouverture » de la mer, pour Heidegger, serait sans doute une ouverture inquiétante, unheimlich étrange, démesurée, sans limite, sans horizon, monotone. Le fameux concept d’Abgrund (le « gouffre » ou « abîme ») pourrait, transposé dans l’élément marin, devenir aisément un maelström, un tourbillon sans fond.
Si l’on garde cela à l’esprit et que l’on revient à l’exemple du paysan et du pêcheur, un autre problème se présente. Le travail du paysan est lié à la semence : il peut penser le blé que cette semence « représente », ou, autour de la hutte de Heidegger, l’arbre que ses racines représentent pin ou sapin, peu importe. Ce lien de représentation reste pensable, quoique fragile.
Mais pour le pêcheur, une telle relation de représentation est beaucoup plus problématique. Qu’est-ce qui, par exemple, pourrait « représenter » la matière première de son travail ou la racine de la mer qui l’environne ? Le pêcheur est celui qui capture les poissons ; son labeur est orienté vers cette capture. Pour cela, il jette son filet à la mer et, à travers ce filet, tire quelque chose de l’eau. En un mot : il retire toujours davantage que ce qu’il y a jeté. Ni le filet qu’il lance ni le filet qu’il remonte ne contiennent un « germe », une « racine » ou une « essence » comparable à celles du paysan. Ils ne font que transporter ce qu’ils attrapent un poisson, ou peut-être, un jour, une vieille chaussure rejetée par la mer.
C’est là tout le problème du rapport de représentation pour le pêcheur : dans l’acte de tirer, on ramène toujours un excédent par rapport à ce qui a été jeté. Comment, dans ces conditions, un pêcheur penserait-il l’Être ? Il ne pourrait le concevoir à partir de la manifestation d’une essence enracinée dans la semence ou la racine, mais plutôt à travers ce transport même ce passage, ce tirage du filet. Un Être non pas substantiel, mais translatif, non pas enraciné, mais mobile. En bref, entre le filet jeté à la mer et le filet retiré de l’eau, aucun rapport de représentation n’est possible.
Ainsi, si Heidegger était né dans un village de pêcheurs, il aurait peut-être pu qualifier son abri, comme il le fit pour sa hutte de montagne, de « mon monde de travail ». Mais il n’aurait sans doute pas pu dire, à propos de l’expérience d’ermitage qu’il y vivait si différente de la simple solitude que l’on peut éprouver en ville, que « la solitude, au sommet de la montagne, ne nous isole pas, mais possède cette puissance propre et originaire qui projette toute notre existence dans la proximité vaste et paisible de la Présence [Wesen] ».
Car il n’aurait pas pu, comme il le fit dans ce même texte, comparer le fait « d’introduire quelque chose dans la logique du langage » à « la résistance des sapins majestueux face à la tempête ». On ne trouve pas de sapins sur le rivage. Sur la mer ou au bord de la mer, à l’hameçon du pêcheur se prendront peut-être une vieille botte jetée, peut-être une bouteille contenant un message d’un naufragé solitaire ou d’un amoureux rêveur, ou, plus probablement aujourd’hui, un sac plastique ou une canette de soda. Mais la mer, elle, engloutit même le Titanic. Et, de surcroît, elle transforme jusqu’à l’eau du fleuve qu’elle reçoit en sa propre substance.
C’est à partir de ces réflexions que le livre d’Ibrahim Kalın, Voyage vers la hutte de Heidegger, prend un autre relief : envisager la cabane de Heidegger comme une cabane de pêcheur, par le détour espiègle du paysan et du pêcheur, permet d’en saisir le sens profond. D’abord parce qu’une telle espièglerie ne signifie pas s’éloigner de la pensée de Heidegger, mais au contraire s’en approcher autrement.
Lorsque j’étais encore étudiant de licence au second semestre de l’année universitaire 1992-1993, je suivais les cours de philosophie de Charles P. Bigger, celui-là même qui nous faisait lire Être et Temps. Ancien historien rigoureux de la philosophie analytique anglo-saxonne, il s’était, comme dans le poème de Tarancı, « au milieu du chemin », tourné vers la philosophie continentale, parvenant ainsi à faire dialoguer les deux traditions. Bigger abordait souvent les concepts ou les phrases de Heidegger avec une sorte de malice douce : il lisait une phrase, puis riait tout seul. Ce comportement, qui d’abord déconcertait, n’avait rien d’une simple malveillance ou d’une ironie facile ; je compris plus tard qu’il s’agissait, en vérité, d’une manière d’approcher le sens d’un concept ou d’une phrase par ce qui la déborde, d’établir une proximité avec ce qu’elle laisse entrevoir.
Cette proximité, bien sûr, peut être positive ou négative, selon la disposition de celui qui la met en œuvre. Mais une chose est certaine : la malice même, et peut-être surtout, en philosophie aide davantage à saisir la portée d’un concept ou d’une proposition qu’une adhésion immédiate à son énoncé. Transformer la hutte de Heidegger dans la Forêt-Noire en un abri de pêcheur sur une côte ne relève donc pas d’un simple exercice d’imagination ou d’une tentative de polémique par déplacement du contexte. Heidegger n’était pas un homme de mer, et ce fait a profondément marqué non seulement sa manière de penser l’Être, mais aussi la forme même de ses phrases, le rythme de sa parole. (J’entends ici quelque chose de bien différent de ce que Luce Irigaray, dans sa lecture psychanalytique Nietzsche, l’amant de la mer, observe chez Nietzsche, qu’elle décrit comme un homme craignant l’eau fluide et féminine; j’espère que cette distinction apparaîtra clairement à la fin de cet article.)
Ainsi, la relation de Heidegger à la mer peut servir d’introduction pour évaluer l’ouvrage d’Ibrahim Kalın, Voyage vers la cabane de Heidegger. Si Heidegger avait écrit ses œuvres non pas dans une cabane de montagne, mais dans un abri de pêcheur situé sur le rivage d’un village maritime, et si, sur la base de notre hypothèse selon laquelle sa pensée de l’Être aurait alors présenté, au moins du point de vue de la “représentation”, certaines différences, le titre du livre avait été Voyage vers l’abri de Heidegger au lieu de Voyage vers la cabane de Heidegger, peut-être que certains chapitres par exemple ceux relatifs aux informations données sur la cabane ou les passages à caractère autobiographique décrivant le voyage vers celle-ci auraient différé.
Mais Kalın aurait dit à peu près les mêmes choses sur l’Être. Voilà justement ce qui rend le livre de Kalın, Voyage vers la cabane de Heidegger, particulièrement intéressant : cette spécificité même.
Pour éclaircir ce point, il faut peut-être ajouter une troisième cabane à la cabane de montagne de Heidegger et à celle du pêcheur que nous avons imaginée. Si, dans son livre Voyage vers la cabane de Heidegger, Ibrahim Kalın avait abordé la cabane visitée par Heidegger dans le village de Todtnauberg à partir d’une autre cabane située sur les hauts plateaux d’Erzurum; une cabane au coin de laquelle, près d’une source, il aurait chanté des airs tels que le magnifique “Hani yaylam hani senin ezelin” en s’accompagnant au saz, alors peut-être parlerions-nous d’autres choses.
Cependant, Kalın ne relate pas sa visite à la cabane de Heidegger — dont il détaille les aspects à l’aide de nombreuses photographies — en se limitant à méditer sur la conception heideggérienne de l’Être. Certes, lorsque la cabane visitée est celle de Heidegger, la notion d’Être devient inévitablement, sinon un point de départ, du moins un prétexte.
Il convient de souligner avec soin que la notion heideggérienne de l’Être n’est pas un point de départ : elle n’est tout au plus qu’un prétexte pour penser l’Être. Car, comme le dit Kalın, “Nous avons besoin de penser pour devenir voisins de l’Être, et besoin d’être voisins de l’Être pour penser.”
Ici, “penser” ne désigne pas une activité purement intellectuelle ; il s’agit du penser qui surgit d’une expérience vécue dans un champ, au cœur d’une tempête, ou sous la rudesse de la nature et qui, pour la philosophie, constitue aussi un moment parfait. En ce sens, “être voisin de l’Être” (parvenir à son ouverture) et “penser l’Être” (s’en imprégner, s’y confondre) se complètent mutuellement.
Mais comme ces activités complémentaires impliquent une circularité, Kalın considère la question du “point de départ” comme “importante”, certes, mais non “insurmontable”. Pour instaurer cette circularité, il suffit simplement “d’entrer dans l’anneau quelque part” (p. 39).
Ainsi, Voyage vers la cabane de Heidegger pense l’Être lui-même, sans imaginer une troisième cabane dans les montagnes d’Erzurum, en entrant “quelque part” dans la notion heideggérienne de l’Être. Cela signifie également qu’il sort la notion d’Être du cadre strictement heideggérien. Chez Kalın, Heidegger et sa cabane deviennent un “lieu d’habitation” visité afin d’observer comment, dans la pensée de Heidegger, la cabane et son environnement offrent ou présentent une certaine “ouverture” vers l’Être.
Mais cet “habitat” n’installe pas Heidegger, comme l’affirme Sharr dans La Cabane de Heidegger (p. 109), dans une “relation rigide avec l’existence”. La cabane n’est pas le monastère de Heidegger. Elle n’est ni le tombeau d’un saint ni celui d’un sage. C’est pourquoi, chez Kalın, l’éloignement de l’Être par rapport à son sens strictement heideggérien est tout à fait significatif. D’une part, cela empêche Kalın de devenir un simple représentant de Heidegger en Turquie, ou un agent de sa pensée dans le contexte turc. D’autre part, cela ouvre la voie à la question suivante : par quels autres moyens faut-il penser et contempler l’Être ?
Penser la cabane de Heidegger non pas “uniquement en évaluant son importance dans la vie et la pensée du philosophe”, mais “en recherchant sa place dans le grand cercle de l’Être”, c’est déjà “avoir fait un pas vers le domaine de l’Être, du sens et de la vérité” (p. 52). C’est précisément pour cette raison que le livre porte le titre de “voyage” : un voyage qui, prenant Heidegger pour prétexte, médite sur la notion d’Être. C’est un voyage différent de celui du “fleuve” chez Heidegger un autre type de cheminement.
Cependant, lorsque l’on réfléchit aux conséquences qu’implique le fait de prendre Heidegger et sa cabane comme prétexte pour penser et contempler l’Être, une question surgit dans le contexte heideggérien : lorsque la “vérité de l’Être” est définie comme “trop vaste, trop profonde, trop dynamique, fluide et pleine de vitalité pour être enfermée dans des cadres” (p. 41), et que l’on commence à interroger le rapport d’une telle définition de l’Être avec le concept de l’Être dans la pensée occidentale, deux possibilités se présentent. La première, c’est de se voir exposé à une forme de “traditionalisation” telle que Derrida la met en lumière dans l’ouverture de son séminaire Onto-theology of National Humanism (Prolegomena to a Hypothesis) consacré aux “nationalismes philosophiques”. Cette traditionalisation ne consiste pas seulement à tenter d’assigner à certaines écoles de pensée des désignations nationales et enracinées comme “la philosophie analytique anglaise”, “la philosophie romantique allemande” ou “le post-structuralisme français” ; elle s’étend aussi, par exemple, à l’établissement de rapports “cachés” entre Heidegger et la pensée asiatique, comme le soutient Richard May dans Heidegger’s Hidden Sources: East-Asian Influences on His Work, ou à la mise en avant, comme chez Marlène Zarader dans La dette impensée : Heidegger et l’héritage hébraïque, d’une relation encore inexplorée de “dette” entre la pensée de Heidegger et l’héritage hébraïque. Derrida insiste d’ailleurs particulièrement sur les liens qu’on cherche à tisser entre “le post-structuralisme” ou la “déconstruction” et la “pensée zen”, soulignant qu’il existe toujours, “dans chaque patrie philosophique, des penseurs désireux de ranimer le tissu philosophique national, de fonder une véritable tradition, de revisiter le corpus et l’héritage de leur nation”. Or, comme nous l’avons déjà mentionné en affirmant que Kalın ne parle pas depuis une hypothétique cabane située sur les plateaux du Palandöken à Erzurum, cette première éventualité se trouve d’emblée écartée dans son cas : Kalın ne cherche ni à ressusciter, ni à inventer, ni à instituer par le biais de Heidegger une pensée “indigène” de l’Être.
Lorsque l’on réfléchit ainsi aux conséquences du fait de prendre Heidegger et sa cabane comme un prétexte pour penser et contempler l’Être et que l’on définit la “vérité de l’Être” comme “trop vaste, trop profonde, trop dynamique, fluide et pleine de vitalité pour être enfermée dans des cadres”, la seconde possibilité qui se présente dans le contexte heideggérien est aussi celle qui explique, en un sens, la raison de notre hypothèse un peu malicieuse formulée au début du texte : celle d’imaginer pour Heidegger, non pas une cabane de montagne, mais une cabane de pêcheur au bord de la mer. En visitant Heidegger et sa cabane comme un prétexte susceptible de les libérer, pour ainsi dire, de la relation de “représentation” dans laquelle ils sont pris, Kalın, en définissant l’Être comme “vaste, immense, profond, dynamique, fluide et plein de vitalité”, projette en quelque sorte Heidegger dont la pensée n’a jamais réussi à franchir le “fleuve”, ni même à le faire parvenir jusqu’à la mer non pas dans un simple abri de pêcheur au bord de l’eau, mais dans un “océan sans rivage”.
Heidegger pourrait-il supporter une telle épreuve ? C’est un mystère. Mais, comme nous l’examinerons dans le prochain texte, en réfléchissant à ce que signifierait “faire tourner un chapelet devant la cabane de Heidegger”, il sera possible d’esquisser quelques observations à ce sujet.