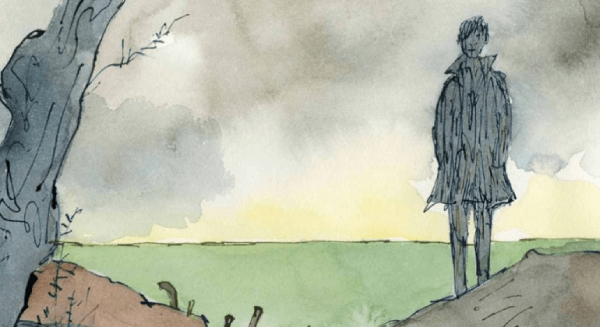Le fait d’appeler l’État « mère » nous semble plus approprié, en raison du lien direct entre l’image de l’autorité générale et les pratiques de l’éducation des enfants et de la « maternité » dans la société. Qualifier l’État de « mère » possède une valeur explicative notable quant aux sentiments et attitudes ambivalents que nous nourrissons envers l’autorité, comme l’ont révélé presque toutes les études psychologiques individuelles et sociales.
Dans l’espoir de clarifier davantage la relation entre l’État et la psychologie de l’individu, empruntons cette fois un nouveau sentier, en abordant la question à travers ce que sont l’autorité et l’anti-autorité.
Qu’est-ce que l’autorité ?
Le disciple de Heidegger, Hans-Georg Gadamer, ne s’intéresse pas seulement aux problèmes engendrés par le recul de la raison pratique moderne ainsi que de la moralité et de la politique qui lui sont associées. Il pousse si loin les thèses du cercle herméneutique de Heidegger et du rôle déterminant de la tradition, qu’il adopte une posture justifiant les préjugés et l’autorité sous le nom « d’herméneutique de la tradition », ce qui lui vaudra d’être étiqueté comme un « réactionnaire anti-Lumières et anti-science ». Une bonne lecture de Gadamer permet de comprendre l’injustice de ces accusations. Toutefois, lorsqu’il affirme : « L’histoire ne nous appartient pas, c’est nous qui lui appartenons. Bien avant que nous nous comprenions par le processus d’examen de soi, nous nous comprenons de manière évidente au sein de la famille, de la société et de l’État dans lesquels nous vivons. La prise de conscience de soi de l’individu vibre sans cesse dans le cercle vicieux de la vie historique », Gadamer ne cache pas qu’il puise sa matière linguistique et conceptuelle dans le cadre systématique de Hegel.
Avec la conscience historique et la tradition, Gadamer légitime également l’autorité et l’État. Bien qu’il ne nie pas son lien avec l’héritage hégélien, le fait qu’il ne s’implique pas intensément dans la philosophie politique l’amène à ne pas suffisamment insister sur les similitudes entre sa pensée et la conception hégélienne de l’État. Par conséquent, il ne nous est pas toujours très utile pour comprendre la relation entre la « raison pratique » et l’État. Pourtant, le fait qu’il accorde une importance fondamentale à Aristote, qui voyait dans la raison pratique la source de la moralité et qualifiait l’homme d’« animal politique », n’échappe pas aux observateurs. De même, le lien entre cette approche et la conception hégélienne de l’État comme enraciné dans la « morale objective » (Sittlichkeit), ainsi que sa vision du « républicanisme civilisé », mérite l’attention. Si nous restons attentifs à ces points de connexion, Gadamer peut nous éclairer davantage dans notre compréhension de la relation entre l’État et la psychologie de l’individu.
Ce qui pousse Gadamer à défendre l’autorité et l’État dans son herméneutique de la tradition, c’est sa distinction entre « autorité », « autoritarisme » et obéissance aveugle. Contrairement à ce que l’on croit, selon lui, l’autorité ne repose pas fondamentalement sur la contrainte, l’agressivité ou la soumission aveugle. L’autorité consiste à reconnaître et à accepter que l’autre est supérieur à soi dans sa capacité de jugement, qu’il nous précède. L’autorité ne peut être offerte à quelqu’un en cadeau ; elle se gagne et doit se gagner dans le dialogue. Elle repose sur l’assentiment, non sur l’obéissance ; elle ne peut être irrationnelle ou arbitraire. En mettant l’accent sur les préjugés qu’il considère comme inévitables, qu’il lie à la structure même de la compréhension et à la priorité de la pratique, Gadamer avance ainsi vers une légitimation de l’autorité, qu’il associe ensuite à la tradition. Nos traditions et coutumes, même lorsqu’elles ne sont pas nommées explicitement, détiennent une forme d’autorité. Leur pouvoir sur nos attitudes et nos comportements ne se contente pas de constituer nos fondements : il se transmet également aux générations futures. Nos attitudes et comportements sont largement déterminés par elles, en dehors des critères rationnels. La préservation de la tradition, dans la mesure où elle repose sur un choix libre de l’individu, tout autant qu’une révolution ou une innovation, fait d’elle un élément de l’histoire et de la liberté, donc un concept lié à la raison.
Au-delà de tout ce qui précède — à savoir que le comportement politique et moral (la raison pratique) constitue un terrain commun entre l’État et la psychologie de l’individu —, la conclusion à tirer est que toute forme d’autorité, y compris celle de l’État, doit reposer sur l’assentiment de l’individu et sur son choix rationnel. Aucune autorité ne peut survivre indéfiniment par la contrainte, la domination ou la manipulation exercées sur autrui ; et les autorités qui choisissent l’autoritarisme comme mode d’existence ne font en réalité qu’écourter leur propre durée de vie. Car, en effet, la dignité humaine a toujours eu la force de vaincre la torture ; on ne peut imposer aux hommes une forme nouvelle et durable de « vie bonne » par la pression physique ou la domination. Ceux qui prétendent y parvenir devraient réfléchir profondément à la nature humaine avec laquelle ils entendent fonder un tel monde.
Il est vrai que chaque être humain a un seuil de résistance à la contrainte physique, mais céder face à la violence ne signifie pas pour autant que son esprit se mette au service du tyran.
Dans les contextes de violence manifeste, il arrive que l’on choisisse, pour se protéger de l’agresseur, une forme d’identification à celui-ci — il s’agit là d’un mécanisme de défense psychologique. Toutefois, chez l’adulte, cela reste un état partiel et transitoire : le soi (le « self », ou nafs) se rétablit dès que l’occasion s’y prête. En revanche, chez les individus exposés à de telles violences dès la petite enfance, il peut se former des pathologies durables du soi, parmi lesquelles des structures de personnalité autoritaires ; les nouveaux oppresseurs naissent souvent de ces environnements destructeurs. Mais ces cas exceptionnels ne sauraient être généralisés à la relation entre l’autorité — en tant que condition humaine — et l’individu.
L’autorité est directement liée à la légitimité et au prestige issus de la pensée, du savoir et de l’expérience de vie. C’est précisément pour cela que, dans de nombreuses langues, le terme d’« autorité » est étymologiquement lié à celui d’auteur ou de créateur d’une œuvre. Il existe, dans tout « dialogue », une autorité, explicite ou implicite. L’autorité n’est pas ce qui s’impose de force dans le dialogue, mais ce qui se révèle à travers lui. Ce que Nietzsche croyait avoir découvert sous le nom de « volonté de puissance » constitue en réalité une forme pervertie de l’autorité : aucun véritable dialogue n’a encore été établi, aucune autorité n’a encore émergé, et les parties, dans cette attente, déversent leurs potentiels les uns sur les autres, n’hésitant pas à user de la force. Jusqu’à ce qu’un dialogue s’instaure, et que l’autorité se fasse reconnaître…
Le concept « d’agir communicationnel » chez Habermas, avec son idée d’un « espace de communication idéal », ne vise pas à supprimer l’autorité, mais peut être interprété comme une proposition sur la manière dont celle-ci devrait être constituée.
L’État est l’autorité générale que la société peut produire à partir d’elle-même — y compris le droit exclusif d’user légitimement de la force — ; il constitue la preuve que la société possède un dialogue général qui lui est propre, il est la raison pratique que la société approuve. C’est pourquoi l’on dit : « Vous êtes gouvernés comme vous le méritez » ou encore « c’est votre État ». En ce sens, « la politique et la morale » doivent être comprises comme les formes selon lesquelles le dialogue et l’autorité se réalisent dans l’espace public.
Pour résumer :
Le terrain commun qui établit le lien entre l’État et la psychologie de l’individu, c’est la politique et la morale. L’État et l’individu fondent tous deux leurs actions sur la « raison pratique », en prenant en compte « l’autre » et la « relation ».
L’autorité est un résultat direct du dialogue ; il y a dans chaque dialogue une autorité, mais celle-ci ne s’obtient pas par la contrainte ou la force : elle repose sur l’assentiment, et ne peut être exercée de manière irrationnelle ou arbitraire.
La légitimité des actions politiques de l’État en tant qu’autorité réside dans la morale objective de la communauté, dans le style général de dialogue de celle-ci. Cette légitimation n’est pas une manipulation idéologique de l’État ; au contraire, l’État doit se conformer à l’assentiment de la communauté.
Qu’est-ce que l’anti-autorité ?
Il est indéniable que cette perspective sur l’autorité et l’État laisse plusieurs questions en suspens. Les plus significatives concernent les « appareils répressifs et idéologiques de l’État » ainsi que les initiatives opposées à l’État. Si l’État repose sur des bases ontologiques et rationnelles aussi solides, et même les formes les plus oppressives de gouvernance sont considérées comme légitimes par la morale objective de la communauté, pourquoi alors recourt-il à la répression et à la production idéologique pour assurer sa pérennité ? Et pourquoi, malgré ces fondements évidents, certains individus entreprennent-ils des actions opposées à l’État ? Les réponses attribuant ces phénomènes à des « influences extérieures » tendent à classer les individus comme « conservateurs », tandis que celles qui nient les caractéristiques structurelles de la société et de l’État les qualifient généralement de « progressistes ». Bien que nous prenions en compte ces réponses de droite et de gauche, nous les jugeons insuffisantes. Nous estimons que ces zones d’ombre résultent du fait que la perspective présentée précédemment ne prend pas suffisamment en compte les dimensions irrationnelles de l’existence et des relations humaines. Nous pensons que ces lacunes peuvent être comblées grâce à la « critique idéologique » et aux outils offerts par la psychologie individuelle et sociale.
L’existence humaine englobe des potentiels positifs tels que la raison et la morale, mais elle est, dès le départ et simultanément, irrationnelle. Les origines de toute rationalité sont enracinées dans l’irrationalité. L’irrationalité initiale de l’homme s’explique par le fait que la rationalité nécessite un certain développement neuropsychologique et social. En plus de son aspect rationnel, l’homme est également un être irrationnel, un « être de désir », que l’on parle d’instincts ou de pulsions.
L’autorité, que nous avons précédemment liée à la raison pratique (politique et morale), émerge principalement des aspects irrationnels de l’homme. L’une des différences majeures entre l’homme et les autres êtres vivants est sa longue période d’enfance. Une enfance prolongée signifie une période de dépendance prolongée. Les racines de notre première acceptation de l’autorité se trouvent dans cette expérience inévitable d’une enfance prolongée. Le fait que nous ne puissions survivre sans la présence d’autrui pour prendre soin de nous s’inscrit profondément et de manière indélébile dans notre psyché. Nous faisons l’expérience de la nécessité de l’autorité dès notre premier dialogue. En ce sens, il semble plus approprié de considérer l’autorité comme débutant avec la mère plutôt qu’avec le « père », souvent perçu en psychologie comme le « troisième » qui perturbe la fusion initiale. D’ailleurs, les études sur le « surmoi » ont identifié ses premières manifestations bien plus tôt dans l’enfance que ne le pensait Freud, ce qui soutient cette perspective. La « mère suffisamment bonne », dans les bras sécurisants de laquelle nous nous abandonnons, que nous le voulions ou non, est également à l’origine de l’image positive de l’autorité et de l’État dans notre monde intérieur. Les inévitables déceptions vécues avec la mère sont, quant à elles, à l’origine de l’image négative de l’autorité et de l’État.
Ce dilemme se prolonge tout au long de notre existence : ce qui nous émerveille, nous permet de fusionner avec l’autre et répond à nos besoins alimente en nous le « bon », tandis que ce qui nous déçoit, nous laisse seuls et impuissants nourrit le « mauvais ». Notre expérience de l’autorité, ce que nous appelons autorité et la manière dont nous y réagissons, est déterminée par l’image générale de l’autorité, formée de l’amalgame de ces représentations du « bon » et du « mauvais ». Ce sont précisément ces aspects « bons » et « mauvais » de l’image générale de l’autorité qui constituent la force motrice de notre « anti-autorité » intérieure. Lorsque nous sommes confrontés à des attitudes de l’autorité ou de l’État que nous jugeons inappropriées, ces composantes sont activées ; l’assentiment se transforme alors en critique ou en révolte. Les individus engagés dans un mouvement d’opposition agissent soit parce que l’autorité en place ne correspond pas à leurs aspects « bons » de l’image d’autorité, soit parce qu’elle évoque les aspects « mauvais » de cette même image.
C’est pourquoi, étant donné le lien direct entre l’image générale de l’autorité et les pratiques sociétales de l’éducation des enfants et de la « maternité », il nous semble plus approprié de désigner l’État comme « mère ». Nommer l’État « mère » éclaire d’une manière pertinente les sentiments et attitudes ambivalents envers l’autorité, tels qu’ils sont relevés dans presque toutes les études de psychologie individuelle et sociale.
Si l’on ne s’attarde pas sur le contenu du désir, mais plutôt sur sa circulation, et en se fondant sur les données empiriques issues notamment de l’expérience en psychothérapie de groupe, on peut avancer les affirmations suivantes à propos de l’autorité et de l’anti-autorité. Le désir humain oscille entre deux pôles : le besoin d’une culture commune et la crainte de voir son autonomie individuelle se dissoudre dans le groupe — autrement dit, entre liberté et solidarité. C’est aussi cette oscillation qui explique notre ambivalence face à l’autorité. Parfois, nous sollicitons l’aide de l’autorité pour préserver la culture commune ou notre autonomie individuelle ; de même, parfois nous adoptons une attitude anti-autoritaire pour défendre cette culture commune ou notre autonomie individuelle.
En conclusion, l’État possède des racines profondes dans la morale collective et dans la nature dialogique des relations humaines. Mais il est tout aussi vrai que, du point de vue de la psychologie individuelle et sociale, l’autorité qu’il incarne s’ancre elle aussi dans des structures tout aussi profondes. Cette dualité inhérente à la psyché humaine engendre chez l’État des réflexes défensifs, ainsi qu’un combat idéologique pour sa propre « survie ». En tant qu’unique autorité légitime à user de la force, il est, dans une certaine mesure, compréhensible que l’État déploie de telles réactions.
Cependant, lorsque ces réflexes défensifs et cette lutte idéologique deviennent le cœur même de son action, cette « certaine mesure » est alors dépassée : l’autorité s’est dégradée en autoritarisme. Et bien que cela ne soit nullement sa vocation première, l’État finit par n’être perçu, surtout par ceux engagés dans une lutte anti-autoritaire, que comme l’adversaire d’un conflit.
Pourtant, si la société mérite encore d’être gouvernée, si elle dispose toujours des fondements moraux et politiques nécessaires, alors, quelle que soit l’issue de cette lutte, l’autoritarisme est voué à disparaître. Et l’État, en tant qu’autorité légitime, réapparaîtra tôt ou tard à l’horizon.