Le concept impérialiste de « diviser pour mieux régner » est une politique visant à affaiblir un État, une région ou un peuple en le fragmentant afin d’en prendre le contrôle. En revanche, « Gouverner en unifiant » est une approche qui cherche à protéger la société concernée de la faiblesse induite par sa division. Elle vise à éliminer les discordes mutuelles résultant de l’exploitation des différences sociales existantes et à maintenir la cohésion de la société. La Turquie adopte une politique unificatrice non seulement pour les Kurdes, mais aussi pour toute la région.
Echanges et présentation : Mustafa Ekici
M. İbrahim Aydın est un officier à la retraite qui a servi pendant 37 ans dans l’armée turque avec le grade de général de division. Au cours de sa carrière, il s’est principalement concentré sur la lutte contre le terrorisme et les renseignements. Aujourd’hui, il mène des recherches académiques sur le Moyen-Orient au Centre d’Études sur le Moyen-Orient (ORSAM). Grâce à ses 37 ans d’expérience de terrain en matière de sécurité et de renseignement, les travaux d’İbrahim Aydın offrent une perspective unique, combinant savoir académique et expérience pratique.
L’entretien que nous avons réalisé avec M. İbrahim Aydın au sujet de son livre « Les Kurdes en Syrie » propose une vision sereine et éloignée de toute rhétorique partisane sur l’un des thèmes centraux de l’actualité : les Kurdes de Syrie, le YPG/SDG et la place des Kurdes dans l’avenir de la Syrie. Dans son ouvrage, İbrahim Aydın retrace l’arrière-plan historique de la présence kurde en Syrie et compile des informations sur leur structure sociale, démographique, culturelle et socio-économique. Le livre se concentre sur les structures politiques des Kurdes syriens, les organisations et partis qu’ils ont fondés, les axes idéologiques sur lesquels reposent ces formations, leurs relations, leurs luttes, leurs liens avec le régime baasiste, ainsi que leur positionnement et leurs alliances durant la guerre civile syrienne. Rédigé en 2023, alors que la guerre civile syrienne était encore en cours, le livre d’Aydın analyse également la situation et l’avenir des Kurdes et du PYD/SDG dans l’après-guerre.
Dans le cadre du débat sur la « question kurde », relancé récemment par l’appel du président du MHP, Devlet Bahçeli, qui a eu un large écho dans la société, la question des Kurdes de Syrie suscite sans aucun doute la curiosité de nombreuses personnes. Les Kurdes syriens, un élément clé de la politique et de la société syriennes, représentent un enjeu majeur pour la Turquie, qui ne peut rester indifférente à leur sort. Le soutien du régime baasiste au PKK, motivé par des considérations géopolitiques, les transformations culturelles et politiques qu’il a induites, les migrations massives provoquées par la guerre civile syrienne et les événements du 6-7 octobre sont autant de preuves que les Kurdes de Syrie ne sont pas un phénomène lointain pour la Turquie.
Comme dans toutes les dynamiques nationalistes, le nationalisme kurde pousse les Kurdes vivant dans différents pays à se projeter dans un univers émotionnel et politique commun. Avec le développement des moyens de communication et de transport, ce processus s’accélère encore davantage. De plus, ce mythe d’un « Kurdistan divisé en quatre parties », présenté de manière romantique et déconnecté des réalités, constitue un terreau fertile pour les groupes terroristes radicaux et les mercenaires agissant pour le compte d’intérêts étrangers.
Aujourd’hui, un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner. Des régimes considérés comme inébranlables s’effondrent en quelques jours. Le Moyen-Orient, en particulier, se trouve à l’aube de bouleversements majeurs. Dans ce contexte, il est évident que les relations que la Turquie cherche à renforcer avec ses deux voisins immédiats, la Syrie et l’Irak, basées sur la sécurité et le développement, se transformeront progressivement en une forme d’alliance. Il ne fait aucun doute que les Kurdes vivant aux frontières de ces trois États, parfaitement intégrés aux sociétés concernées et bilingues pour la plupart, joueront un rôle important dans cette dynamique.
Il est clair que les Kurdes de Syrie ne sont ni éloignés ni simplement voisins de la Turquie, mais qu’ils font partie intégrante de son environnement immédiat. À cet égard, le travail de M. İbrahim Aydın, en tant qu’ancien militaire, revêt une importance particulière.
Bonne lecture,
Mustafa Ekici / Regard Critique

« Les Kurdes de Syrie peuvent devenir fondateurs en s’émancipant de la tutelle du PKK/PYD »
Mustafa Ekici : Votre livre Les Kurdes en Syrie est l’un des rares travaux de référence sur la question des Kurdes syriens à l’échelle mondiale. De plus, il a été rédigé en 2023, à une époque où un changement de pouvoir en Syrie était encore considéré comme une possibilité lointaine, ce qui lui confère une valeur particulière. Pourquoi avoir choisi de traiter spécifiquement des Kurdes de Syrie ?
İbrahim Aydın : Tout d’abord, je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon livre.
Pourquoi les Kurdes de Syrie ?
La question des Kurdes en Syrie est une problématique conjoncturelle. Cependant, il serait plus juste de dire que mon choix est le fruit d’une accumulation issue de plus de 40 ans de carrière et de recherches personnelles, plutôt qu’un simple produit du contexte actuel.
Permettez-moi d’élargir un peu ma réponse afin d’expliquer plus précisément mon objectif avec ce livre.
Lorsque l’organisation terroriste PKK a lancé ses premières actions de grande envergure le 15 août 1984, j’étais un jeune officier avec seulement un an d’expérience. Dès mes premières affectations jusqu’à ma retraite avec le grade de général de division, l’essentiel de mes fonctions, que ce soit sur le terrain ou en état-major, a été consacré à la lutte contre le terrorisme. (D’ailleurs, cette situation ne m’était pas propre ; presque tous mes collègues ayant servi à cette période ont assumé la même responsabilité.) Après ma retraite, j’ai poursuivi mes recherches sur le sujet et je continue encore aujourd’hui. Ainsi, mon parcours professionnel m’a permis de confronter théorie et pratique dans la lutte contre le terrorisme, tandis que mes études post-retraite m’ont offert la possibilité d’examiner la question sous des angles autres que celui du terrorisme. Mon intérêt pour ce sujet repose donc sur ces bases solides.
Le thème que nous abordons est une question ancienne qui s’étend de l’Empire ottoman à la République et qui, aujourd’hui encore, se prolonge au-delà du premier siècle de la République turque. Nous avons été témoins, depuis au moins un demi-siècle, des efforts déployés par l’État turc et du coût considérable qu’il a dû supporter dans ce cadre. Que Dieu protège notre État. Toutefois, l’absence d’une feuille de route stratégique claire, acceptable et durable sur cette question a toujours été soulignée. Nos travaux nous ont montré que la mise en place d’une telle feuille de route n’est possible que si l’on comprend la question dans toute sa complexité. Mon travail de recherche vise justement à appréhender cette globalité, et le livre Les Kurdes en Syrie peut être considéré comme le fruit de ce processus d’apprentissage.LesKurdes, qui sont les principaux concernés par cette question séculaire, ne vivent pas uniquement en Turquie, et les plans impérialistes les concernant ne se limitent pas à la Turquie. De plus, les dynamiques internes qui affectent les Kurdes ont un potentiel d’interaction considérable avec les pays voisins. C’est pourquoi notre champ d’étude inclut également les pays où vivent les Kurdes.
Si j’ai choisi d’accorder une priorité particulière à la Syrie, c’est parce que les effets de la récente guerre civile y ont profondément transformé la situation des Kurdes syriens. En effet, entre la séparation de la Syrie de l’Empire ottoman et le début de la guerre civile, les Kurdes syriens ont vécu dans une relative isolation, privés de volonté politique en raison de multiples facteurs sociaux, géographiques, politiques et administratifs. Je souhaitais donc comprendre et mettre en lumière l’effet multiplicateur qui, après la guerre civile, leur a permis d’émerger en tant qu’acteurs influents.
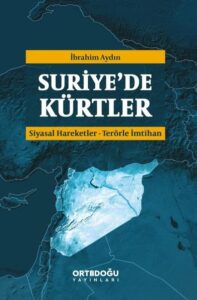
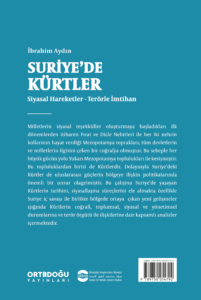
« L’émergence du pluralisme politique kurde en Syrie et son évolution vers une hégémonie du PYD »
M. Ekici : Lorsqu’on analyse les organisations politiques mises en place par les Kurdes de Syrie, on constate une ampleur qui semble disproportionnée par rapport à la structure historique et démographique de la présence kurde en Syrie. Dans votre ouvrage, vous mettez en avant à la fois des facteurs « externes », tels que l’attention portée par l’administration ottomane à la continuité de l’organisation tribale kurde, les activités impérialistes et les politiques mises en œuvre sous le mandat français, et des facteurs « internes », comme les migrations et les activités politiques des Kurdes vivant dans les pays de la région. D’où vient cette diversité des organisations et des activités politiques kurdes en Syrie, qui se manifeste par la présence de dizaines de partis couvrant l’ensemble du spectre politique ? Comment expliquez-vous l’évolution récente de ce pluralisme vers une forme d’uniformité sous l’autorité du PYD ?
İ. Aydın : L’émergence des mouvements politiques kurdes en Syrie n’est, en réalité, pas un phénomène récent. Bien avant la guerre civile, il existait un mouvement kurde qui s’inscrivait dans des dynamiques internes propres, tout en étant influencé par les évolutions régionales. Toutefois, il est difficile de dire que ces mouvements étaient des structures solidement organisées et puissantes. Ils étaient plutôt marqués par une fragmentation et une relative faiblesse, sans orientation politique claire.
Néanmoins, plusieurs événements ont favorisé l’agitation et la diversité au sein de la politique kurde en Syrie. Comme on le sait, après la Première Guerre mondiale et le redécoupage des frontières, une partie de la population kurde est restée en Syrie sous mandat français. Par ailleurs, après la répression des révoltes kurdes en Turquie dans les années 1920 et la fondation en 1927 à Beyrouth – alors sous contrôle français – de l’organisation Hoybun, un afflux migratoire kurde vers la Syrie s’est produit. Dans le cadre de leur politique de « diversification ethnique », les autorités françaises ont accordé la citoyenneté syrienne à ces Kurdes et leur ont attribué, aux côtés d’autres minorités, une place dans l’armée et la police bien supérieure à leur poids démographique.
Cette situation a perduré un certain temps après le départ des Français, mais, à partir de la seconde moitié des années 1950, avec la montée en puissance du parti Baas et l’essor du nationalisme arabe, des restrictions ont été imposées aux Kurdes, notamment en matière d’enseignement et de publications en langue kurde. En 1958, avec la création de la République arabe unie entre la Syrie et l’Égypte, le nationalisme arabe a pris une ampleur considérable, entraînant l’éviction de centaines de Kurdes, y compris des officiers supérieurs, de l’armée. Ces mesures ont contribué à la politisation des Kurdes.
Dans ce contexte, et sous l’influence du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) d’Irak, le Parti démocratique kurde de Syrie a été fondé. L’arrestation de son secrétaire général et de plusieurs cadres en 1960 a marqué le début d’une répression systématique du gouvernement syrien contre les Kurdes, perçus comme une menace à l’intégrité nationale et à l’identité arabe du pays. D’autres politiques ont accentué la marginalisation des Kurdes, notamment la redistribution des terres dans le nord-est du pays pour promouvoir l’arabisation, ainsi que le recensement de 1962 à Hassaké, qui a conduit à la révocation de la citoyenneté d’environ 120 000 Kurdes sous prétexte qu’ils ne pouvaient pas prouver leur résidence en Syrie avant 1935.
En outre, à partir de la fin des années 1970, les mouvements politiques kurdes en Turquie ont également influencé les Kurdes de Syrie. Le soutien du régime syrien au PKK a offert à ce dernier une opportunité d’expansion parmi les Kurdes syriens, façonnant ainsi les structures politiques kurdes en Syrie et menant à la prolifération de nombreux partis, malgré leurs similitudes idéologiques et politiques.
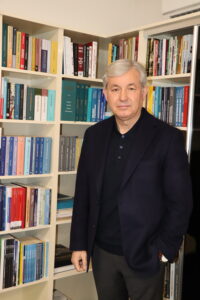
Quant à l’évolution récente de ce pluralisme vers une domination du PYD, plusieurs facteurs doivent être pris en compte.
Premièrement, le PYD s’est construit sur l’héritage du PKK, qui, depuis 1979, a bénéficié du soutien du régime syrien et s’est imposé comme le principal mouvement kurde en Syrie. Deuxièmement, la faiblesse et le manque de cohésion des autres partis kurdes ont empêché l’émergence d’une alternative crédible au PYD, lui offrant ainsi un espace d’expansion considérable. Troisièmement, le soutien initial du régime syrien au PYD au début de la guerre civile a consolidé sa position. Enfin, l’intervention des États-Unis dans le conflit syrien a permis au PYD de bénéficier d’un soutien direct de la part de Washington, renforçant ainsi son emprise sur la scène politique et militaire kurde en Syrie.
Il est bien connu que Hafez el-Assad, en raison de conflits structurels avec la Turquie – notamment sur la question de Hatay et des ressources en eau –, a offert au PKK un refuge à partir de 1979, permettant ainsi à l’organisation de survivre alors qu’elle était en passe d’être éradiquée en Turquie. En autorisant le PKK à s’implanter parmi les Kurdes syriens, le régime syrien a facilité son développement et favorisé les recrutements au sein de la population locale.
Bien que le PKK ait perdu le soutien direct du régime syrien au début des années 2000, en raison de l’amélioration des relations entre Ankara et Damas, il a pu continuer à opérer en Syrie sous le couvert du PYD, une organisation écran. Contrairement aux autres partis kurdes, souvent fragmentés et en lutte les uns contre les autres, le PYD a su fédérer un large socle de militants et de sympathisants, ce qui lui a permis de s’imposer comme la force dominante du mouvement kurde en Syrie.
Pendant la guerre civile, le PYD a été la seule organisation kurde à bénéficier du soutien exclusif du régime. Dès le début du conflit, grâce à cet appui, il a pu établir des conseils dans les régions kurdes, ouvrir des écoles de langue et des centres culturels, multiplier les bureaux du parti et ainsi se créer un vaste espace de propagande, lui permettant de rallier de nombreux partisans.
De plus, contrairement aux autres groupes kurdes, le PYD disposait d’une structure armée, ce qui lui a offert un champ d’action et de domination bien plus large. Alors que les autres partis kurdes rencontraient de sérieuses difficultés à établir une nouvelle organisation et à s’unir, le PYD, d’un côté, est entré en conflit avec certains d’entre eux et, de l’autre, s’est donné l’image d’un défenseur des droits des Kurdes afin de canaliser la contestation contre le régime d’Assad. En prenant en charge certaines fonctions délaissées par l’État en raison du vide d’autorité, il a également su susciter la sympathie de la population.
Surtout, à partir de 2014, le soutien direct des États-Unis au PYD/YPG dans le cadre de la lutte contre Daech a définitivement consolidé la position du PYD/YPG, le rendant incontestable parmi les groupes kurdes.
En conclusion, le pluralisme politique qui caractérisait jusqu’alors les groupes kurdes en Syrie a progressivement cédé la place à une hégémonie du PYD, soutenu tant au niveau local que par les grandes puissances internationales.
Les Kurdes ne vivent pas uniquement en Turquie, et les plans et manipulations impérialistes à leur égard ne se limitent pas à ce pays. De plus, les dynamiques internes et les évolutions qui en découlent ont un fort potentiel d’interaction avec les pays voisins. C’est pourquoi nos recherches incluent également les pays où vivent les Kurdes. La priorité accordée spécifiquement à la Syrie s’explique par les répercussions de la guerre civile récemment achevée sur les Kurdes syriens.
M. Ekici : Dans votre livre, vous affirmez que la politique administrative ottomane à l’égard des Kurdes reposait sur le principe de « gouverner en unifiant ». Pourriez-vous détailler ce concept ?
İbrahim Aydın : Je pense que le concept de « gouverner en unifiant » peut être mieux expliqué en le comparant à son contraire, à savoir la politique du « diviser pour régner ». Le « diviser pour régner » est une stratégie qui vise à affaiblir une population, une région ou un État en les fragmentant, afin d’en assurer le contrôle. Cette politique repose sur l’exacerbation des différences ethniques, culturelles et religieuses lorsqu’elles existent, ou, en leur absence, sur l’introduction de discorde au sein de la société. Une fois la division instaurée, il s’agit d’infiltrer les factions opposées pour les manipuler selon ses propres intérêts (ce qui rappelle la stratégie bien connue de « tension contrôlée »). Cette technique permet également de contrôler divers groupes d’intérêts susceptibles de s’opposer collectivement à l’autorité en place.
Depuis l’époque romaine, la politique du « diviser pour régner » a été utilisée comme un moyen de neutraliser les petits États. Elle peut être considérée comme un projet impérialiste visant à rendre une entité plus facile à soumettre et à assimiler. Au XIXe siècle, cette stratégie a été appliquée lors de la création des empires coloniaux, notamment pour diviser les populations asiatiques et africaines et ainsi faciliter leur gouvernance. À la fin de la Première Guerre mondiale, la définition arbitraire des frontières au Moyen-Orient, sans tenir compte des critères ethniques, tribaux, religieux ou linguistiques, ainsi que la formation d’États multicommunautaires vulnérables à la fragmentation, sont également des manifestations de cette politique. Aujourd’hui encore, les stratégies impérialistes visant à redessiner les frontières du Moyen-Orient relèvent d’un modèle de « diviser pour régner », qu’on les qualifie de néocolonialisme ou de nouvelle forme d’impérialisme. Ce modèle privilégie l’influence sur les pays en développement non pas par l’occupation militaire directe ou par des interventions politiques classiques, mais à travers le capitalisme, la mondialisation et l’impérialisme culturel.
Le professeur Teoman Duralı illustre bien la méthode du « diviser pour régner » en expliquant comment le système éducatif anglo-juif a contribué à affaiblir la cohésion sociale et l’unité nationale de l’Empire ottoman. Il évoque également l’Inde comme exemple : « En Inde, d’un côté, des privilèges étaient accordés aux castes supérieures, tandis que de l’autre, on inculquait aux castes inférieures, sous l’influence de la conception chrétienne de Dieu, l’idée que tous les hommes, créés à l’image du Christ, étaient égaux. L’objectif était de fragmenter la société indienne. »
Dans cette optique, la politique du « gouverner en unifiant » peut être définie comme une approche visant à protéger une société des faiblesses engendrées par la division. Elle consiste à éliminer les conflits internes et les discordes susceptibles d’être exploitées par des forces extérieures, afin de préserver l’unité de la société. Cette approche peut être adoptée pour des raisons de sécurité et de stabilité, mais elle peut également répondre à des considérations pragmatiques. D’ailleurs, dans notre livre, le concept de « gouverner en unifiant » contient une part de pragmatisme.
Comme l’indique Hakan Özoğlu dans son ouvrage Le Nationalisme kurde à l’époque ottomane, la principale raison pour laquelle l’Empire ottoman a adopté cette politique était son besoin des notables kurdes pour asseoir sa légitimité, ces derniers revendiquant des origines arabes. Par exemple, dans la Sharafnama, la famille dirigeante de Cizîrê affirme descendre de Khalid ibn al-Walid, tandis que les dirigeants de Çemişgezek et de Hakkâri rattachent leur lignée aux Abbassides.
M. Ekici : Les recommandations d’application du plan d’action en 12 points, préparé en 1963 par un lieutenant des services de renseignement du Parti Baas, apparaissent comme des mesures radicales pour l’époque. On estime que des provocations d’origine sécuritaire, telles que l’incendie du cinéma d’Amude et les événements du stade de Qamichli, qui ont eu des effets profondément traumatisants sur la communauté kurde de Syrie, ont servi à terroriser les Kurdes syriens. Pourriez-vous expliquer l’impact de ces politiques et provocations du régime baasiste sur les structures politiques des organisations kurdes en Syrie ?
İbrahim Aydın : Dans notre ouvrage, ces événements sont évoqués de manière générale, sans prendre position sur leur véracité absolue ni sur la question de savoir qui avait raison ou tort. Ils sont rapportés tels qu’ils ont été racontés jusqu’à présent ou tels qu’ils apparaissent dans les sources. Vous conviendrez qu’un livre de cette nature ne permet pas d’examiner ces événements un par un en détail, et ce n’est d’ailleurs pas son objectif. L’objectif ici est de souligner comment les dynamiques internes ont été exploitées comme un levier de propagande par le nationalisme kurde, contribuant ainsi à la politisation des Kurdes.
Qualifier ces événements d’actions visant à terroriser les Kurdes par des provocations sécuritaires relève d’une interprétation très avancée. L’élément clé à noter ici est que ces événements ne se sont pas seulement limités à la politisation de la société autour de l’identité kurde, mais qu’ils ont également servi à en faire un élément central de l’opposition à l’identité fondatrice et au régime de l’État. En réalité, cette situation ne se limite pas à la Syrie ; des méthodes similaires ont été employées dans tous les pays où vivent des Kurdes.
Cette question renvoie aussi aux « dynamiques internes » qui interviennent dans l’ensemble des activités du nationalisme kurde, au-delà de l’influence des puissances impérialistes qui en sont les principales instigatrices et soutiens. Ainsi, plutôt que de restreindre le sujet aux seules influences impérialistes, il est nécessaire d’évaluer simultanément comment les développements internes ont été utilisés comme un outil de propagande par les cercles politiques et transformés en un instrument clé de gestion des perceptions.
La répression et l’infiltration du régime en Syrie ont entraîné des divisions et des conflits internes au sein des partis kurdes. De plus, l’exclusion des Kurdes par l’opposition arabe pendant la guerre civile a également contribué à faire des organisations et partis basés en Irak et en Turquie des pôles d’attraction pour les Kurdes de Syrie, les incitant à se rapprocher de ces structures.
M. Ekici : Dans votre livre, il ressort que presque toutes les organisations kurdes en Syrie sont liées à des partis et organisations fondés en Irak et en Turquie. Comment interprétez-vous cette dépendance des Kurdes syriens vis-à-vis des mouvements politiques kurdes en Irak et en Turquie ?
İ. Aydın : Nous pouvons aborder cette question d’un point de vue chronologique. Jusqu’à ce qu’une partie des nationalistes kurdes de Turquie commencent à s’installer en Syrie au début du siècle dernier, il n’était guère possible de parler d’une conscience nationale kurde politisée parmi les Kurdes de Syrie. Cependant, les révoltes survenues pendant la Guerre d’indépendance de la Turquie, ainsi que la répression de la révolte de Cheikh Saïd après la fondation de la République, ont poussé les chefs tribaux impliqués dans ces événements ainsi que certains membres des clubs kurdes d’Istanbul – qui ne se sentaient plus en sécurité après ces soulèvements – à se réfugier en Syrie. À la suite des mouvements culturels qu’ils ont initiés, une prise de conscience identitaire s’est développée parmi les Kurdes de Syrie, et les symboles kurdes ont commencé à être revendiqués.
Le résultat le plus marquant des efforts de réorganisation menés par ces figures kurdes en Syrie a été la création de la société Hoybun, fondée avec le soutien du Royaume-Uni et de la France en coopération avec les Arméniens. Cette organisation, qui visait à établir un État kurde indépendant dans la région, a permis à de nombreux Kurdes d’acquérir une identité politique et a contribué à l’émergence d’un mouvement kurde local, à la fois culturel et politique, en Syrie.
À partir de la fin des années 1950, l’influence du Parti démocratique du Kurdistan (KDP) irakien a commencé à se faire sentir parmi les Kurdes de Syrie. Les tensions entre les nationalistes arabes et les Kurdes, qui ont commencé au milieu des années 1950 et se poursuivent encore aujourd’hui, ont permis au KDP irakien de jouer un rôle actif dans la lutte politique des Kurdes syriens. En effet, sous son influence, le Parti démocratique du Kurdistan de Syrie (Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriyê, KDP-S) a été fondé en 1957. Toutefois, en raison des pressions et infiltrations du régime syrien, une première scission officielle est survenue en 1965. Par la suite, plus de dix partis kurdes ont vu le jour après s’être séparés du KDP-S. Ces partis, considérés comme illégaux en Syrie, ont commencé à mener leurs activités politiques dans la région kurde d’Irak à partir de 1991.
Après les événements de Qamichli en 2004, un exode massif des Kurdes syriens vers le Kurdistan irakien a eu lieu. Ceux qui ont fui ont été installés dans deux camps distincts près de la ville de Dohouk, dont la gestion et la sécurité étaient assurées par le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK). Dès lors, les politiques menées par le KDP pour influencer les dynamiques kurdes en Syrie se sont poursuivies jusqu’à la guerre civile. Dans ce contexte, le Conseil national kurde (Encûmena Nîştimanî ya Kurdî, KNC), créé en octobre 2011 dans le but de rassembler sous une même structure les partis kurdes syriens et de pallier leurs faiblesses organisationnelles, a été en grande partie le fruit des efforts du KDP. De plus, au cours de la guerre civile, le KDP a également réussi à organiser les Kurdes ayant fui vers le nord de l’Irak.
Le deuxième facteur d’influence sur la politique identitaire des Kurdes syriens est issu de la Turquie. Il s’agit des effets de la présence du PKK en Syrie, initiée par l’arrivée de son leader Abdullah Öcalan en 1979, et prolongée à partir des années 2000 par le Parti de l’Union démocratique (PYD). Nous avons déjà évoqué ces influences de manière générale plus haut.
Il ne serait cependant pas juste d’expliquer cette dépendance uniquement par les activités du KDP irakien et du PKK/PYD. En effet, la répression du régime syrien et son infiltration au sein des partis kurdes ont provoqué des divisions et des conflits internes. De plus, l’exclusion des Kurdes par l’opposition arabe pendant la guerre civile a renforcé l’attractivité des organisations et partis basés en Irak et en Turquie pour les Kurdes de Syrie. Ces facteurs ont contribué à les rapprocher de ces structures.
Concernant cette dépendance, il était peut-être pertinent d’en parler jusqu’à récemment. Cependant, à l’avenir, on peut affirmer que les Kurdes de Syrie ont atteint une capacité à agir de manière plus indépendante. Cela pourrait leur offrir l’opportunité de se sentir davantage syriens et de se concentrer sur une solution qui s’inscrit dans l’intégrité territoriale de la Syrie.
M. Ekici : Vous affirmez que les Kurdes en Syrie, en tant que minorité relativement petite et historiquement « pacifique », n’ont pas créé d’organisations politiques ou armées ayant des revendications maximalistes, contrairement aux organisations kurdes dans d’autres pays. Pouvez-vous expliquer l’existence du PYD à partir de cet argument ?
İ. Aydın : En effet, avant la guerre civile en Syrie, mis à part les effets issus des conditions internes des Kurdes, une série de politiques économiques et sociales menées dans le but de créer un équilibre démographique, telles que l’installation de populations arabes parmi les Kurdes et d’autres raisons stratégiques, ont conduit la majorité des Kurdes à ne pas chercher à revendiquer des séparatismes ou d’autres revendications similaires, mais plutôt à entretenir des relations étroites avec le gouvernement central. Par conséquent, il n’y a pas eu de structures armées kurdes en Syrie avant cette période.
Bien que la situation décrite semble paradoxale en ce qui concerne l’existence du PYD, il est important de souligner que le PYD n’est pas une organisation syrienne. Il n’a pas été fondé par des Syriens, ni dirigé par des Syriens. Le fait de confier la direction de l’organisation à un Syrien est entièrement un choix du PKK. L’élévation de la question kurde ou du PYD à ce niveau relève de ce que ce livre appelle « l’effet multiplicateur » : l’influence des puissances impérialistes et des dynamiques internes.
Cependant, il n’est pas possible de dire que les Kurdes n’ont jamais soulevé de revendications politiques. Nous avons précédemment expliqué les développements qui ont dominé la politisation des Kurdes. Même si ces revendications ne sont pas allées jusqu’à la sécession, on peut dire qu’elles ont mis en avant des demandes politiques centrées sur l’identité kurde. À ce sujet, nous pourrions mettre en évidence deux développements stratégiques majeurs ayant influencé les revendications politiques kurdes. Le premier est l’incident de Qamichli en 2004. Le second est la prise de contrôle par les partis kurdes – principalement le PYD – de la ville d’Ayn al-Arab (Kobané) le 19 juillet 2012, suivie de la prise de plusieurs autres villes et localités en quelques jours seulement.
L’un des résultats les plus importants des événements de Qamichli a été que certains jeunes Kurdes ont commencé à se préparer à la lutte armée en formant des organisations de jeunesse clandestines. Parmi celles-ci, deux groupes peuvent être mentionnés, créés en mars 2005 : le Mouvement de la Jeunesse Kurde et le Mouvement de la Libération du Kurdistan. Le Mouvement de la Libération du Kurdistan a notamment commencé des actions armées en mars 2008, et on dit qu’il a tué plusieurs agents des services secrets de la police syrienne. C’est la première fois dans l’histoire de la Syrie que le Mouvement de la Libération du Kurdistan a mené une lutte militaire contre le régime. Hormis ce groupe, les partis kurdes n’ont jamais mené de lutte armée. En réalité, la formation des YPG (Unités de Protection du Peuple) a également fait suite aux manifestations contre le gouvernement en 2004, mais leur déclaration de formation a eu lieu après que les forces du régime ont évacué les zones kurdes et que les éléments des YPG se sont installés dans les bâtiments administratifs du gouvernement.
Le deuxième événement majeur a été la création des bases de la future région kurde de Syrie, un projet à long terme. C’est dans ce cadre que nous pouvons analyser l’existence du PYD et son influence.
M. Ekici : Quelle a été l’attitude des Kurdes en Syrie face aux soulèvements contre le régime Baas et comment ont-ils évolué au cours de ce processus ?
İ. Aydın : Initialement, les Kurdes ont adopté une approche prudente face aux manifestations qui ont commencé en mars 2011. Cela était dû à l’incertitude sur l’identité de l’opposition et à l’ignorance de la stratégie qu’elle envisageait à l’égard des Kurdes. Il a été affirmé que le manque de prise en compte des revendications kurdes par l’opposition arabe pour un système politique décentralisé en Syrie avait éloigné les partis kurdes des principaux groupes d’opposition. Cependant, en mars et avril 2011, des manifestations ont eu lieu dans les régions kurdes telles que Kamishli, Amude, Dirbesiye, Derik et Ras al-Ayn, dans un esprit de solidarité avec les manifestations dans d’autres régions du pays. Mais ces manifestations n’ont pas attiré beaucoup d’attention car elles n’ont généralement pas été marquées par des violences. Certains ont trouvé trompeuse l’impression que les Kurdes étaient initialement distants des manifestations. Selon cette vision, en réalité, les acteurs politiques kurdes ont réagi différemment aux manifestations dans les zones arabes de Syrie, mais la situation s’est apaisée lorsque Bachar al-Assad a annoncé en avril 2011 la restitution de la citoyenneté syrienne aux Kurdes apatrides, et que par un décret en date du 7 avril 2011, la citoyenneté syrienne a été attribuée à tous les « étrangers » (les non-syriens), ce qui a d’abord affaibli les manifestations dans les régions kurdes.
Ce qui est vraiment frappant, c’est la tolérance dont ont fait preuve les forces du régime vis-à-vis des manifestations dans les zones kurdes. Bien que les Kurdes aient participé aux manifestations qui ont ouvert la voie à l’insurrection en Syrie, il y a eu une grande tolérance à leur égard, et les centres urbains kurdes n’ont pas subi les attaques destructrices du régime comme d’autres villes où se trouvaient des opposants. Cela a non seulement contribué A rendre la région relativement plus sûre, mais a également offert aux groupes kurdes l’opportunité de renforcer leurs forces.
En réalité, tout comme l’opposition générale en Syrie, les Kurdes au début des événements manquaient d’un mouvement politique et d’un leader capable de les guider. Cependant, bien qu’ils n’étaient pas en Syrie, le PKK et le KDP, grâce à leurs structures organisées et leur capacité à influencer les Kurdes syriens en raison de leur passé, ont rapidement réussi à contrôler les masses kurdes à travers les structures qu’ils ont établies en Syrie. La méfiance des Kurdes envers les Arabes sunnites et leur relative distance vis-à-vis de la lutte armée au début ont été bénéfiques pour le PYD et le KDP. Ainsi, les deux organisations ont trouvé l’opportunité de diriger les Kurdes qui étaient laissés sans guide.
Ces nouvelles conditions en Syrie, et en particulier le vide de pouvoir laissé par le retrait du régime des zones kurdes, ont créé des changements fondamentaux dans la politique kurde, permettant aux Kurdes de prendre des mesures plus audacieuses pour garantir leurs droits, tout en s’affirmant de manière plus confiante. Ces conditions ont en réalité créé une opportunité sans précédent, non seulement pour l’obtention des droits kurdes, mais aussi pour jouer un rôle influent dans la politique nationale. Toutefois, toutes les démarches dans ce sens ont été perçues par les opposants arabes comme du séparatisme. L’une des raisons de cette perception négative était la connaissance de l’agenda séparatiste du PKK/PYD. Malgré cela, la réaction de l’opposition arabe aux revendications kurdes a rapidement éloigné les Kurdes de la participation active aux groupes d’opposition principaux, les poussant à créer un bloc kurde visant à protéger et représenter leurs intérêts.
Ainsi, au cours du processus de guerre civile, le PYD et le KDP ont joué des rôles déterminants dans la lutte des Kurdes, formant la principale colonne vertébrale des alliances entre les organisations kurdes. En fin de compte, les Kurdes sont entrés dans la cinquième année de la guerre civile sous deux principaux blocs : d’une part le Conseil national kurde (KNC) sous la direction du KDP, et d’autre part le Mouvement pour la société démocratique (TEV-DEM), dont le PYD est la composante principale. Début 2016, un troisième bloc a été formé sous le nom de Coalition de l’unité nationale kurde (Indépendants), suite à la réunion de cinq partis kurdes syriens.
Parmi ces groupes, c’est le PYD qui a émergé de manière dominante, disposant à la fois d’une organisation armée et, au début, de l’appui du régime syrien, puis du soutien des forces de la coalition dirigée par les États-Unis sous prétexte de la lutte contre l’État islamique (ISIS). En mars 2016, le PYD, sous la direction de son mouvement TEV-DEM, a déclaré la formation de la « Fédération démocratique de la Syrie du Nord et Rojava », annonçant ainsi la mise en place d’une opposition autonome dans une région indépendante.

M. Ekici : Pouvez-vous expliquer le système de « cantons » mis en place par le PYD en Syrie ? Quels effets ce système aura-t-il à court et à moyen terme sur la structure de la société kurde en Syrie ?
İ. Aydın : Comme on le sait, le terme « canton » évoque avant tout la Suisse. Par conséquent, le concept est étroitement associé au système administratif et politique suisse. Cependant, le canton ou l’autonomie n’est pas limité à la Suisse, car c’est également un type de division administrative appliqué dans de nombreux pays à travers le monde, comme la Bolivie, la France, le Costa Rica et la Bosnie-Herzégovine. En ce sens, il n’est pas possible de parler d’une seule forme de canton. Par exemple, en Suisse, il fait partie d’un système fédéraliste, tandis qu’en France, il s’agit d’une unité administrative intégrée dans un système très centralisé.
Malgré ces différences d’application, le concept de canton est généralement lié à des approches politiques telles que la décentralisation, l’autonomie locale et le fédéralisme, et il est défini comme un type de division administrative qui met en avant la localité, la démocratie locale et l’autonomie, plutôt que l’institutionnalisation du pouvoir central.
En prenant l’exemple de la Suisse, qui est considérée comme un modèle réussi pour les cantons, il faut noter que le pays a quatre langues officielles (allemand, français, italien et romanche). Il n’est donc pas possible de parler d’une nation suisse basée sur une ethnie ou une langue commune. Par conséquent, c’est l’autonomie locale et le pluralisme culturel permis par les cantons et le fédéralisme fort qui sont considérés comme les facteurs fondamentaux permettant à la Suisse de maintenir son « intégrité ». Cependant, après la guerre ethnique sanglante en Bosnie-Herzégovine, le système cantonal conçu pour garantir la majorité ethnique et religieuse entre les Croates et les Bosniaques a entraîné une division ethnique stricte, définissant la politique sur la base de l’ethnicité et ne laissant pas de place aux revendications politiques et sociales autres qu’ethniques. Ainsi, il n’est pas correct de dire que le système cantonal est une panacée, qui servirait systématiquement la diversité culturelle et la démocratie. Le modèle libanais, proposé pour le Moyen-Orient, par exemple, consiste à répartir les postes de l’État entre les représentants de certaines communautés ethniques et religieuses selon des proportions spécifiques. Ce système est censé apaiser les tensions ethniques et religieuses et partager le pouvoir, mais en réalité, il laisse entièrement l’espace politique aux représentants des groupes ethniques et religieux, compartimentant ainsi les communautés ethniques et religieuses. Cette forme de démocratie ethnique ou sectaire invisibilise les revendications politiques au-delà des identités culturelles, rigidifie les groupes ethniques et religieux, les enferme et réduit considérablement la perméabilité entre les groupes différents.
Quant aux cantons créés par le PYD dans le nord-est de la Syrie, bien que la gestion de ces cantons soit formée d’un Conseil législatif (parlement), d’un Conseil exécutif (gouvernement) et d’une Commission de justice (judiciaire), et que des institutions telles que la Haute Commission électorale et la Haute Cour constitutionnelle aient été mises en place, en tenant compte des conditions de leur émergence et de leur mode de fonctionnement, il est évident qu’il est impossible de les comparer aux systèmes existants ailleurs dans le monde en termes de participation et d’autonomie locale. Par exemple, la fonction de ces administrations cantonales est de mettre en œuvre et d’appliquer les décisions prises par le Mouvement pour la société démocratique (TEV-DEM), qui constitue l’aile sociale du système mis en place en Syrie par le PKK et le KCK. Cela signifie que ces cantons ont été créés pour servir un système mis en place par une organisation extérieure à la Syrie, comme le PKK/KCK. De plus, les Kurdes, qui sont une minorité représentant moins de 20 % de la population de la région, ne sont pas représentatifs de la réalité sociale de la région. En effet, ces cantons n’ont pas été acceptés par la population locale, et pour pallier cette situation, des représentants des minorités religieuses et ethniques ont été intégrés dans les nouvelles structures de gestion des cantons afin d’assurer un équilibre.
Par ailleurs, le nouveau gouvernement syrien a clairement insisté sur le fait qu’aucune forme de structure autonome ne serait autorisée en Syrie. Par conséquent, il est possible de prévoir que le système en question n’aura pas de place ni d’influence sur l’avenir de la Syrie ou des Kurdes.
Le modèle de canton contient soi-disant un aspect qui apaiserait les tensions ethniques et religieuses et répartirait le pouvoir ; cependant, il a aussi la caractéristique de laisser entièrement le domaine politique aux représentants des groupes ethniques et religieux, compartimentant ainsi ces groupes. La transformation de la démocratie en une démocratie ethnique ou confessionnelle rend invisibles les revendications politiques au-delà des identités culturelles, rigidifie les groupes ethniques et religieux, les enferme et réduit considérablement la perméabilité entre les différents groupes.
M. Ekici : Comment décririez-vous la relation du PYD avec la société kurde syrienne et ses capacités de légitimité et de production de consentement, ainsi que sa continuité, en relation avec l’argument « le test des Kurdes avec le terrorisme », alors que cette structure politique, centrée autour du PYD, a établi un territoire couvrant près de la moitié du pays, avec une présence significative dans la lutte contre Daech, d’abord sous l’autorité du régime d’Assad, puis comme une force au sol soutenue par les États-Unis et la coalition internationale ?
İ. Aydın : La relation du PYD avec les Kurdes de Syrie est directement liée au fait qu’il soit le successeur du PKK, héritant des réseaux de relations établis par ce dernier. Par conséquent, il est nécessaire de bien comprendre cette relation.
Le début et le développement de la relation entre le PKK et les Kurdes de Syrie remontent aux années 1980 et 1990, lorsque le régime syrien a permis l’organisation parmi les Kurdes. Grâce à cette autorisation, dans les années 1990, l’organisation a pu influencer la société kurde et diviser la population en groupes, tels que les femmes, les jeunes et les enfants, complétant ainsi l’organisation du Front. Parmi ces groupes de jeunes, une participation importante aux groupes armés a eu lieu. Le plus grand potentiel pour les activités dirigées vers les Kurdes était constitué des familles des militants tués ou engagés dans des actions armées. De plus, en raison du fait que les partis kurdes syriens, dans les années 1980 et 1990, ne possédaient pas de projets clairs et attrayants pour la société kurde, le PKK a comblé ce vide, lui permettant de s’organiser efficacement et de constituer un réseau très performant pour le recrutement de militants et la collecte de ressources financières. Cette relation a duré jusqu’à 1998, lorsque Öcalan et les militants du PKK ont été expulsés de Syrie, et ce réseau a été transféré au PYD dans les années 2000.
Bien que jusqu’à la guerre civile, le PYD n’ait pas exercé une influence aussi importante, la guerre civile a ouvert une opportunité incomparable, notamment à travers la question de la « tutelle » mentionnée dans votre question. De plus, la guerre civile en Syrie a rapproché les Kurdes émotionnellement et politiquement. Cependant, le PKK/PYD, en recevant le soutien du régime et de la coalition dirigée par les États-Unis, a commencé à dominer la région et à établir uniquement ses propres structures, ignorant tous les autres groupes kurdes et les déclarant même comme des ennemis, ce qui a rendu toute coopération entre les Kurdes et les partis politiques kurdes impossible. Un nombre considérable de Kurdes ont fui les régions à majorité kurde, et ceux qui sont restés se sont affrontés. Pratiquement toute la société a été militarisée et des milliers de jeunes Kurdes ont perdu la vie dans les combats. Les activités éducatives, culturelles et similaires ont été presque complètement supprimées, et non seulement l’unité et la volonté commune ont été détruites, mais aussi les espoirs pour l’avenir ont été presque anéantis.
En outre, des violations des droits de l’homme ont eu lieu, telles que la destruction des terres kurdes opposantes et la déportation forcée, des pressions sur les Kurdes opposants, y compris des meurtres, des militants arrêtés soumis à la torture, des disparitions, des enlèvements, des exécutions, des violences contre les femmes et les enfants, ainsi que l’utilisation d’enfants soldats, et des coopérations avec les milices et les services de renseignement du régime, qui ont été documentées par plusieurs organisations internationales.
Compte tenu de tout cela, il est difficile de dire que la structure politique centrée sur le PYD a établi une relation de légitimité et de production de consentement avec l’ensemble de la société kurde syrienne. Le fait que des centaines de milliers de Kurdes des régions contrôlées par le PYD aient trouvé refuge en Irak et en Turquie peut certainement expliquer cette situation. Cependant, il convient de noter que, grâce principalement au soutien des États-Unis et à l’influence des dynamiques internes consolidées au fil des années, le PYD reste un acteur influent parmi les Kurdes en Syrie. Toutefois, en raison de la tutelle du PKK et de problèmes de légitimité, cette influence reste extrêmement fragile. On peut s’attendre à ce que toute perte de pouvoir du PYD modifie considérablement l’équilibre des forces.
M. Ekici : Considérez-vous la présence kurde en Syrie comme une menace politique et militaire pour la Turquie ? Pouvez-vous évaluer les discussions récentes sur le « processus » dans la politique turque en centrant votre analyse sur les Kurdes de Syrie ?
İ. Aydın : Ma nature et ma foi ne permettent pas de nourrir de l’hostilité envers une personne ou un groupe simplement en raison de son identité. Parce que personne n’est un monstre uniquement à cause de son identité, tout comme aucune identité différente n’est notre bourreau. Accepter l’opposé et agir sous l’effet de cette paranoïa ne fait qu’amener l’individu à devenir un tyran. La raison et la conscience nous obligent à rechercher des moyens de coexister et de vivre ensemble. De plus, c’est une approche incroyablement peu coûteuse et un axe de solution définitif. En ce qui concerne cette approche générale, personnellement, je crois que la Turquie doit développer des relations directes et indirectes avec les Kurdes en Syrie et augmenter le dialogue. Dans cette optique, il est également nécessaire de soutenir l’intégration correcte des Kurdes dans le nouveau système de la Syrie.
Quant à la relation entre les discussions sur le « processus » en Turquie et les Kurdes en Syrie, on peut l’évaluer ainsi : Il est très clair que le fait de réduire la Syrie, en particulier à travers la motivation du PKK/PYD, à un outil servant à éloigner la Syrie des intérêts impérialistes et de leurs alliés régionaux ne sera bénéfique ni pour les Kurdes en Syrie, ni pour la société syrienne. Bien sûr, si les Kurdes en Syrie sont instrumentalisés par l’impérialisme, par le biais du PYD, pour servir les plans régionaux de ce dernier, les conséquences négatives de cette situation pour la Turquie seront inévitables. Par conséquent, au lieu d’attendre que les développements en Syrie affectent notre front intérieur, la Turquie a cherché à créer des développements à l’intérieur qui influenceront aussi la Syrie. Si le processus réussit et que le PKK dépose ses armes et se dissout, le PYD sera également débarrassé de l’influence du PKK, ce qui lui permettra de se positionner plus facilement en tant que parti syrien, en tant qu’entité qui voit la Syrie dans son ensemble.
Par ailleurs, je ne vois pas l’approche de la Turquie vis-à-vis du nouveau processus comme une simple manœuvre dirigée uniquement vers la Syrie ; selon moi, il s’agit d’une initiative prise sur la base de la constatation que les conditions internes et l’atmosphère internationale sont favorables, dans le but de mettre fin à un problème chroniqué.
M. Ekici : L’équilibre géopolitique formé autour de l’axe Iran-Russie a changé soudainement à la suite des pertes de capacités et des réorientations des parties dans les guerres en Ukraine et en Israël. Tandis que de nombreuses structures, principalement le régime d’Assad et le Hezbollah, se sont retirées de la scène, pouvez-vous évaluer la probabilité que les YPG restent présentes sur scène ?
İ. Aydın : Il est évident que les YPG ne pourront pas rester sur scène dans leur situation actuelle. Combien de temps un groupe qui a accepté de jouer le rôle de gardien du pétrole pour les États-Unis peut-il subsister dans la région ? Par conséquent, l’existence future des YPG dépendra de leur capacité à se libérer de l’influence et de la tutelle du PKK, et à chercher une place raisonnable dans l’intégrité de la Syrie.
M. Ekici : Quel processus envisagez-vous en Syrie ? Comment évaluez-vous les risques et opportunités que la nouvelle Syrie pourrait offrir à la Turquie en tant que grande puissance régionale ? Et comment positionnez-vous les Kurdes de Syrie dans cette équation ?
İ. Aydın : Toutes les attentes concernant le nouveau processus en Syrie convergent vers une approche qui sera menée exclusivement par les Syriens, éloignée de la violence, pacifique et inclusive, basée sur l’intégrité territoriale de la Syrie et l’unité du peuple syrien. En ce sens, la manière dont le processus de reconstruction de la Syrie se déroulera et la mesure dans laquelle il bénéficiera au peuple syrien dépendra des acteurs du changement, et en particulier de l’implication des Syriens eux-mêmes. À ce point, il est également important de regarder à travers quelles structures et puissances impliquées la guerre s’est menée et qui a eu une influence déterminante sur l’apparition de ce résultat, ce qui n’est pas un secret. Il est désormais clair qu’Iran et Russie n’ont pas été les déterminants finaux. La politique des États-Unis à l’égard du PKK/YPG a également échoué, car le PKK/YPG est préoccupé par sa survie. La Turquie, pour sa part, a eu une influence déterminante dans le résultat actuel avec ses objections aux développements en Syrie qui ont affecté négativement ses intérêts nationaux, y compris des interventions militaires et des relations avec l’opposition. Cependant, cela ne garantit pas que la Turquie aura une influence égale dans la reconstruction de la Syrie. Si l’on se souvient que l’impérialisme nous a contraints à quitter cette région après une lutte de plus d’un siècle, nous pouvons facilement affirmer qu’ils ne permettront pas notre retour dans la région. Cependant, il faut également noter que nos actions pendant la guerre civile ont été menées sans leur consentement. Le régime Baas, avec ses 61 ans de régime répressif et la guerre civile de 13 ans, a beaucoup fatigué et usé le peuple syrien. Les gens recherchent la paix et la tranquillité. Le nouveau gouvernement de la Syrie travaille à la reconstruction d’une Syrie unifiée avec une équipe modérée. La grande majorité des groupes internes adoptent une attitude positive. Les pays voisins, notamment la Turquie et les pays arabes, soutiennent également cette approche avec l’espoir d’aider le nouveau gouvernement. Tout cela indique une base importante. Dans ce sens, il est possible de regarder l’avenir de la Syrie avec espoir. Nous espérons que les pays occidentaux seront sincères dans leur approche de « ne pas laisser la Syrie redevenir un bastion du terrorisme et ne pas représenter une menace pour ses voisins ». Cependant, il est indéniable que cela nécessitera de la vigilance, de la patience et du temps. Des pas ont été faits vers une Syrie libre et paisible à l’ouest de l’Euphrate. Le dernier obstacle devant la Syrie est le terrorisme PYD/YPG à l’est de l’Euphrate. Parce que, tandis que presque tous les groupes soutiennent le nouveau gouvernement, le PYD/YPG cherche à découper des parts de territoire et à étendre son contrôle. L’insistance de groupes comme le PYD/YPG, qui ont une base limitée même parmi les Kurdes et un passé conflictuel avec les Arabes, à jouer un rôle dans la nouvelle Syrie, compliquera la solution et conduira à de nouveaux conflits. Par conséquent, l’inclusion des Kurdes dans la construction de la nouvelle Syrie et leur acceptation dépendra de leur capacité à se libérer de la motivation du PKK/PYD.
M. Ekici : Nous vous remercions beaucoup.
İ. Aydın : Je vous remercie également et vous souhaite santé et bien-être.


