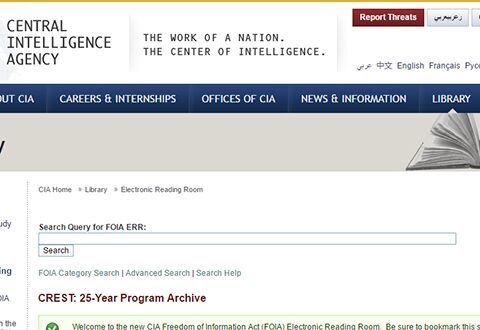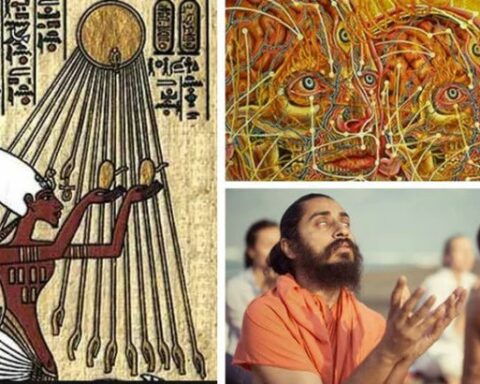L’évolution des États-Unis vers une position de « superpuissance hors-la-loi » s’est construite sur la supériorité structurelle de leur puissance, des opportunités stratégiques et des discours idéologiques. Cependant, les changements dans les dynamiques mondiales et régionales limitent sérieusement la durabilité de cette position. Une éventuelle intervention militaire contre l’Iran mettrait encore plus en évidence le fossé entre la capacité réelle des États-Unis et les réalités du système international, ouvrant la voie à de nouvelles crises militaires, économiques et diplomatiques.
L’ordre mondial unipolaire qui a émergé après la guerre froide a, dès le début des années 2000, commencé à être qualifié par certains comme l’ère de la « superpuissance hors-la-loi », en raison de l’érosion du droit international par les États-Unis et de leurs interventions militaires unilatérales. Durant cette période, les États-Unis ont tenté d’imposer un nouvel ordre mondial unilatéral en s’appuyant sur leur puissance militaire, leur supériorité technologique et économique, ainsi que leur rôle déterminant au sein des institutions internationales. Ce processus a débuté avec l’invasion de l’Afghanistan en 2002, suivie de celle de l’Irak en 2003, et s’est poursuivi avec l’élargissement des opérations militaires au Yémen, au Pakistan et au Soudan — autant d’actions qui ont clairement révélé pour la première fois le visage de la « superpuissance hors-la-loi ».
Lors du second mandat de Donald Trump, les États-Unis n’ont pas seulement exercé des pressions illégales sur leurs alliés et rivaux par le biais de guerres commerciales, mais ont également affiché une tendance révisionniste ouverte à travers des politiques visant à annexer le Canada, le Groenland et le Panama. Leur soutien inconditionnel au génocide perpétré par Israël, l’élargissement récent des attaques militaires directes contre le Yémen, ainsi que la mise en avant constante d’une possible intervention militaire contre l’Iran, ont renforcé le statut de « superpuissance hors-la-loi » des États-Unis, qui bafouent systématiquement le droit international et provoquent l’instabilité mondiale.
L’objectif principal de cet article est d’analyser, dans un cadre conceptuel, les dynamiques structurelles, stratégiques et idéologiques ayant conduit les États-Unis à cette position, tout en discutant les limites de cette posture. L’argument central de l’étude est que, compte tenu des dynamiques actuelles du système international et régional, une éventuelle intervention militaire américaine contre l’Iran ne se contenterait pas de pousser les limites de la capacité militaire et économique des États-Unis, mais rendrait également structurellement insoutenable leur position de « superpuissance hors-la-loi ». Cette situation entraînerait une crise de légitimité accrue au niveau international et exposerait les États-Unis au risque d’une surexpansion stratégique.
Le concept de « superpuissance hors-la-loi » et la transformation de la politique étrangère des États-Unis
Dans la littérature des relations internationales, le concept d’« État voyou » (rogue state) est utilisé pour désigner les États qui violent le droit international, défient les normes mondiales et menacent l’ordre établi. Lorsqu’un tel comportement est adopté par une superpuissance, ce concept est élargi pour devenir celui de « superpuissance hors-la-loi ». Une « superpuissance hors-la-loi » désigne un acteur qui, à l’échelle non seulement régionale mais aussi mondiale, viole systématiquement le droit international, instrumentalise les normes internationales et place l’usage de la force au-dessus de la légitimité. De tels acteurs, en s’appuyant sur leur supériorité militaire, économique et diplomatique, cherchent à remodeler l’ordre mondial selon leurs intérêts, créant ainsi une grave crise de légitimité au sein de la communauté internationale et engendrant une instabilité systémique.
Trois dynamiques fondamentales ont été déterminantes dans la dérive des États-Unis vers une position de « superpuissance hors-la-loi » après l’an 2000 :
Premièrement, le système unipolaire né de la fin de la guerre froide a offert aux États-Unis une asymétrie de puissance absolue, réduisant leur besoin d’adhésion au droit international et aux institutions multilatérales. Le vide structurel laissé par l’effondrement de l’Union soviétique a supprimé tout contrepoids capable de freiner les interventions américaines, encourageant le recours unilatéral à la force.
Deuxièmement, après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont redéfini de manière radicale leurs priorités sécuritaires, officialisant des stratégies contraires au droit international telles que la « doctrine de frappe préventive ». Les invasions de l’Afghanistan (2002) et de l’Irak (2003) n’ont pas seulement été les premières applications de cette nouvelle stratégie, elles ont également profondément alimenté la perception que les États-Unis violaient les normes internationales. Les opérations militaires à grande échelle menées au Yémen, au Soudan et au Pakistan ont confirmé cette orientation stratégique.
Enfin, la tentative des États-Unis de légitimer leur mission globale par un discours fondé sur l’exportation de la « liberté » et de la « démocratie » a nourri une prétention hégémonique sur le plan idéologique. Mais en pratique, cette rhétorique combinée à la violation du droit international a creusé le fossé entre les prétentions normatives des États-Unis et leurs actions, rendant inévitable une crise de légitimité. Cette hypocrisie idéologique est devenue encore plus visible sous l’administration Trump, avec des politiques ouvertement révisionnistes telles que les velléités d’annexion du Canada, du Groenland et du Panama.
En s’appuyant sur sa supériorité structurelle, ses opportunités stratégiques et sa mission idéologique, les États-Unis ont glissé vers une position de « superpuissance hors-la-loi ». Cependant, les récents bouleversements dans les équilibres internationaux et régionaux mettent en évidence les limites de cette posture. En particulier, une éventuelle intervention militaire contre l’Iran révèle l’élargissement du fossé entre les capacités de puissance américaines et la réalité systémique, rendant de plus en plus difficile la soutenabilité de leur position. Une telle intervention ne ferait qu’aggraver la violation du droit international par les États-Unis, tout en accentuant leur isolement croissant et leur perte de légitimité à l’échelle mondiale.
La Capacité de Défense Affaiblie de l’Iran et ses Réalités
Sous le second mandat de Trump, les pressions militaires exercées sur l’Iran par l’axe États-Unis–Israël se sont nettement intensifiées. Des sources proches de Trump et d’Israël évoquent avec insistance, ces derniers temps, la possibilité d’une opération militaire contre l’Iran. Cette évolution indique qu’en pleine montée des tensions géopolitiques régionales, les États-Unis et Israël sont prêts à adopter une stratégie plus agressive à l’égard de l’Iran. Bien que des négociations directes entre l’Iran et les États-Unis aient repris après de longues années et aient progressé de manière significative, l’option d’une opération militaire contre l’Iran reste fortement présente au sein de certains cercles décisionnels de l’administration américaine.
Trois facteurs principaux peuvent être identifiés pour expliquer le maintien de cette option militaire contre l’Iran :
Premièrement, dans la doctrine de sécurité que l’Iran a développée au début des années 2000, une priorité stratégique consistait à contrer toute attaque potentielle au-delà de ses frontières nationales. Cependant, les attaques élargies d’Israël après le 7 octobre ont considérablement affaibli les forces militaires par procuration de l’Iran, en particulier dans la région du Levant et au Moyen-Orient en général. Cette situation a rendu l’Iran vulnérable. L’affaiblissement de ces forces par procuration — l’un des objectifs stratégiques majeurs de l’Iran — a gravement ébranlé la capacité de défense régionale du pays, le rendant plus fragile.
Deuxièmement, la stratégie des guerres par procuration et la politique du « Croissant chiite », que l’Iran a mises en place depuis le début des années 2000, ont suscité une profonde méfiance au sein des régimes conservateurs de la région. Ces régimes, ne disposant pas d’une capacité militaire et industrielle suffisante pour équilibrer l’influence de l’Iran, ont adopté une stratégie de rapprochement avec Israël pour assurer leur sécurité. Par le biais de divers accords signés avec Israël, ces États ont intégré le principal ennemi de l’Iran comme un élément essentiel de leur sécurité nationale. En conséquence, cette alliance a permis à Israël d’élargir considérablement sa marge de manœuvre, notamment dans la région du Golfe, et de renforcer sa position stratégique dans la région.
Enfin, le second mandat de Trump a marqué l’arrivée au pouvoir d’un courant belliciste aux États-Unis. Les hauts responsables de l’administration actuelle manifestent un enthousiasme marqué pour des politiques interventionnistes à travers la région, s’appuyant, comme après le 11 septembre, sur la puissance militaire et industrielle des États-Unis. Cette attitude démontre la volonté persistante d’utiliser la supériorité militaire américaine comme un instrument au service de ses objectifs stratégiques globaux.
Le dossier iranien et les limites de la « superpuissance hors-la-loi »
Bien que les milieux américains et israéliens évoquent fortement l’option militaire contre l’Iran, une analyse des dynamiques régionales et mondiales actuelles suggère que la probabilité d’une opération militaire de grande envergure est sérieusement réduite. Plusieurs facteurs clés contribuent à cette évaluation.
Premièrement, la capacité militaire de l’Iran atteint un niveau susceptible d’influencer directement les équilibres régionaux. Ses compétences en guerre asymétrique, sa puissance balistique et son réseau stratégique de forces supplétives, bien que récemment affaibli, constituent une ligne de défense robuste contre toute intervention étrangère. Une telle intervention deviendrait ainsi plus complexe et coûteuse.
Deuxièmement, la structure démographique de l’Iran, caractérisée par une population jeune et nombreuse, renforce sa capacité à soutenir un conflit prolongé. Contrairement à de nombreux pays de la région, l’Iran dispose d’une réserve humaine importante pour soutenir ses ressources militaires. Cette avantage démographique, combiné à son influence idéologique et politique sur les minorités chiites marginalisées à travers le Moyen-Orient, souligne sa capacité à résister efficacement à des interventions extérieures.
Troisièmement, la profondeur géopolitique de l’Iran renforce sa position stratégique. Situé au cœur du Moyen-Orient, l’Iran exerce une influence significative non seulement sur ses frontières, mais aussi dans des régions critiques telles que le Golfe, le Levant, le Caucase et l’Asie centrale. Toute opération militaire contre l’Iran aurait des répercussions au-delà de ses frontières, affectant directement les dynamiques géopolitiques de ces régions et entraînant des conséquences complexes et étendues.
En outre, la politique américaine actuelle de « superpuissance hors-la-loi » a conduit à une isolation croissante lors d’opérations militaires complexes. Les invasions de l’Afghanistan en 2002 et de l’Irak en 2003 ont suscité une opposition forte de la part de partenaires traditionnels tels que l’Allemagne, la France, la Turquie et l’Arabie saoudite. Ces interventions ont entraîné une isolation internationale significative pour les États-Unis, accompagnée de défis militaires, économiques et diplomatiques majeurs.
Sous l’administration Trump, les relations des États-Unis avec des alliés traditionnels comme le Canada et le Royaume-Uni se sont détériorées, tandis que des tensions économiques ont émergé avec les pays européens. Dans ce contexte, une intervention militaire contre l’Iran, sans le soutien de ses alliés, affaiblirait la capacité opérationnelle des États-Unis sur le terrain et compromettrait leur légitimité mondiale, les exposant à une crise multidimensionnelle.
Par ailleurs, les tendances révisionnistes de plus en plus évidentes des États-Unis encouragent des acteurs comme la Chine et la Russie à adopter des positions plus assertives dans leurs régions respectives. Les politiques américaines perturbant l’ordre international offrent à ces puissances l’opportunité de promouvoir leurs revendications historiques, exacerbant ainsi les tensions géopolitiques. Cette situation affaiblit les efforts des États-Unis pour maintenir l’équilibre des pouvoirs en leur faveur et accélère l’émergence d’un ordre international multipolaire.
Bien que la transformation des États-Unis en « superpuissance hors-la-loi » repose sur une supériorité structurelle, des opportunités stratégiques et des discours idéologiques, les évolutions des dynamiques régionales et mondiales limitent sérieusement la viabilité de cette position. Une éventuelle intervention militaire contre l’Iran mettrait en évidence le fossé entre la capacité actuelle des États-Unis et les réalités du système international, ouvrant la voie à de nouvelles crises militaires, économiques et diplomatiques. De plus, l’isolement croissant des États-Unis vis-à-vis de leurs alliés et l’accélération des initiatives géopolitiques de la Chine et de la Russie affaibliraient davantage les prétentions de Washington à un leadership mondial. Dans ce contexte, même si une intervention militaire contre l’Iran pourrait offrir des gains tactiques à court terme, elle accélérerait à long terme l’effondrement du statut de « superpuissance hors-la-loi » des États-Unis. Conscients de cette réalité, les décideurs américains privilégieront probablement une solution diplomatique plutôt qu’une opération militaire d’envergure contre l’Iran.
*Necmettin Acar, Maître de conférences, Président du Département de Science politique et de Relations internationales, Université Mardin Artuklu. [email protected].*