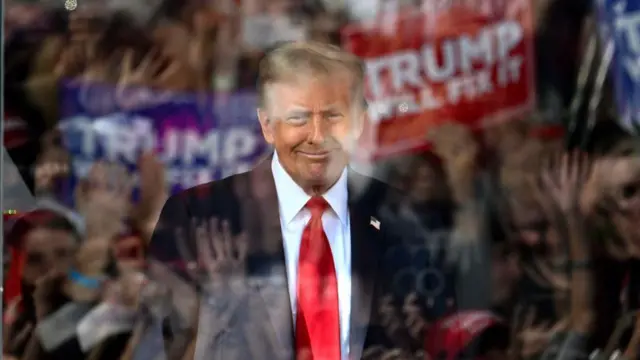Les élections américaines, perçues comme le “scrutin du changement”, auront des conséquences sérieuses pour les Etats -Unis et le monde. Bien sûr, le paysage qui émergera dans les années à venir ne sera pas façonné uniquement par le changement du 5 novembre. Cependant, cette date pourrait intensifier les problèmes et les crises déjà en cours, tant au niveau mondial qu’aux États-Unis. Il est difficile de dire que le premier mandat tumultueux de Trump nous en dit beaucoup sur aujourd’hui. En effet, Trump, en tant que personnage unique en son genre, nécessite qu’on admette que ses propres vérités et son fanatisme seront toujours les principales forces motrices de son action.
Les élections américaines se sont soldées par une victoire de Trump. Les élections ne sont pas toujours centrées sur un changement de pouvoir. Le besoin de changement peut émerger dans de nombreuses élections, mais ce besoin seul ne suffit pas pour que le changement se réalise. Un changement ne se concrétise que s’il existe un acteur ou un support pour le porter et le défendre. Lorsque qu’un tel acteur ou un tel terrain émerge, et que le résultat de l’élection suscite un débat sérieux ou une véritable tension prédictive, alors cette élection devient une « élection de changement ».
Avec la modification de la Constitution en 1951, limitant le mandat présidentiel à deux termes, les États-Unis ont instauré un schéma non déclaré selon lequel un « changement de pouvoir » était attendu tous les 8 ans. Ce cycle a souvent fonctionné comme une règle politique et sociale.
La seule exception où un président d’un même parti a succédé à un autre après huit ans a eu lieu en 1988, avec l’élection de George H.W. Bush. Cependant, Bush a payé le prix d’avoir brisé cette tradition en ne parvenant pas à se faire réélire pour un second mandat. Le changement l’a finalement emporté. Dès le départ, et notamment le 11 août 2020, il était évident que les élections de 2024 seraient une « élection de changement ». En effet, ce jour-là, Joe Biden, choisi non par préférence mais par nécessité, s’est révélé être un candidat problématique pour les Démocrates, avec son manque de vision et de charisme politique.
Comme si cela ne suffisait pas, au lieu de choisir un colistier capable de devenir un héritier politique crédible, avec des qualités de leadership authentiques, Biden a opté pour Kamala Harris, un produit de la perspective libérale apolitique. Avec cette décision, il était clair, avant même son élection, que Biden – déjà perçu comme incapable de terminer son mandat en raison de ses problèmes de santé – et les Démocrates allaient abandonner la bataille en 2024, annonçant ainsi le changement à venir. En refusant les résultats des élections de 2020 et en transférant à sa base le sentiment d’un leader destitué par la force, Trump a de facto lancé sa campagne pour 2024 dès novembre 2020.
Entre 2020 et 2024, tandis que Trump menait une campagne active, Biden et les Démocrates se sont pratiquement enlisés dans une sorte de pacifisme politique. Les troubles cognitifs de Biden, dus à ses problèmes de santé, ont fini par devenir une sorte de démence qui s’est métastasée à l’ensemble du Parti démocrate. En fin de compte, les résultats du 5 novembre n’ont surpris personne : ils étaient attendus. Les deux principales raisons pour lesquelles ces résultats n’étaient pas clairement exprimés étaient, d’une part, les “instabilités” de Trump, si incontrôlées qu’elles masquaient l’impuissance politique des Démocrates, et, d’autre part, des indicateurs économiques suffisamment bons pour remporter une élection.
Il est évident que cette élection a été façonnée par des dynamiques complexes, des fractures historiques, politiques et sociales, un contexte économique et les problèmes spécifiques générés par le fort décentralisme des États-Unis. Cependant, bien que la plupart de ces éléments évoluent parfois, ils ont toujours existé. Ce qui compte, c’est la capacité de ces éléments, lors d’une élection, à converger pour créer un sentiment de changement. Pour l’élection de 2024, une telle vague de changement n’a même pas été nécessaire. La simple présence de Biden, incapable physiquement d’assumer une quelconque responsabilité et dépourvu d’une vision politique crédible (indépendamment de sa justesse ou de son erreur), a suffi à faire du changement la seule option possible. Une fois ce sentiment de changement enclenché, il a été une fois de plus démontré qu’il est presque impossible de l’arrêter, même dans un système électoral anti-démocratique comme celui des États-Unis, qui entrave la volonté des électeurs.
Trump a réalisé l’un des retours les plus spectaculaires de l’histoire politique américaine. Cinq mois seulement après être devenu le premier président condamné pour des dizaines d’accusations dans une salle d’audience, il est entré à nouveau à la Maison-Blanche, devenant ainsi, pour la première fois en 130 ans, le premier président américain à revenir au pouvoir après une interruption de mandat. Comme en 2016 et en 2020, il a exploité jusqu’au bout une rhétorique outrancière. Mais cette fois, deux dynamiques clés ont façonné sa campagne de manière différente.
Premièrement, malgré ses discours radicaux et absurdes, il a tiré parti de ses propositions économiques fondamentales et de sa position cohérente contre les guerres. Il a même pris des mesures que Biden et Harris n’ont pas osé envisager. Pour la première fois dans une campagne présidentielle, un candidat a directement et ouvertement adressé des messages aux électeurs musulmans, leur faisant des promesses claires. De manière ironique, Trump a incarné la “raison” dans les domaines de l’économie et de certaines questions sociales. Il a même fait de cela le slogan de sa campagne : “Nous ne demandons pas grand-chose. Juste un minimum de bon sens.” Il a vraiment su trouver un langage politique qui répondait aux préoccupations sociales et au bon sens : “Un homme est un homme, une femme est une femme. L’immigration illégale doit cesser. La vie coûte trop cher. Nous ne voulons pas de guerre.”
Le deuxième et plus puissant levier de Trump a été les Démocrates eux-mêmes. Ils ont réussi à faire tout ce qu’il fallait pour perdre une élection. Entre une crise des candidats et des erreurs stratégiques dans deux États critiques – erreurs que même un observateur novice des élections américaines ou du système du Collège électoral pouvait rapidement identifier –, les Démocrates se sont révélés paralysés. Ces États clés, où des voix contre la guerre, contre Israël et en faveur des musulmans pouvaient facilement faire basculer l’élection, ont vu les Démocrates faire des choix catastrophiques, compromettant leurs chances sans même tenter de gagner ces électorats.
Dans une élection qui résumait à elle seule la chute de la fertilité des élites américaines – et qui était la première depuis 1976 à ne pas inclure un Bush, un Clinton ou un Biden dans la course –, le Parti démocrate a peut-être retiré le nom de Biden à la dernière minute, mais il a dû entrer dans la bataille avec le spectre de Biden. En fin de compte, les électeurs ont préféré le choix plus tangible et réaliste que représentait Trump. La coalition démocrate, principalement basée sur des minorités ethniques et démographiques, s’est effondrée.
Les élections du 5 novembre aux États-Unis, présentées comme une “élection du changement”, auront des conséquences significatives pour l’Amérique et le monde. Cependant, le paysage qui se dessinera dans les années à venir ne sera pas façonné uniquement dès le jour des élections. Le 5 novembre pourrait néanmoins accélérer les dynamiques des crises et des problèmes déjà en cours, tant pour le monde que pour les États-Unis. La question clé à garder dans l’esprit pour le reste du monde est la suivante : Quelles seront les conséquences d’une Amérique qui, sur le plan militaire et économique, se distingue considérablement du reste du monde? Qui, malgré l’évolution du classement des puissances économiques mondiales, possèdera dans les années à venir une domination technologique sans précédent grâce à des entreprises mondiales influentes. Tout en voyant sa puissance politique diminuer à mesure que ses forces militaires et économiques se dégradent.
Il est évident que le changement intervenu le 5 novembre ne peut fournir une réponse simpliste et immédiate à cette question cruciale. Dans les analyses sur l’Amérique, il est important de se rappeler que les lectures simplistes et spectateurs, souvent centrées sur le personnage de Trump, ont donné des réponses largement trompeuses aux “problèmes américains” ces dernières années. En effet, l’Amérique, dans la période moderne, représente une fusion complexe de transformations politiques, sociales et économiques, marquées par des colonisateurs et des migrants qui ont remodelé l’histoire de l’humanité à une échelle mondiale. Déchiffrer l’alchimie de ce melting-pot, tout comme en effectuer une autopsie politique et sociologique, reste une tâche ardue. Par conséquent, les élections américaines, demeurent un sujet d’analyse complexe avec leurs spécificités et leurs paradoxes.
En gardant cette complexité à l’esprit, si l’on se penche sur la perdante des élections du 5 novembre, Kamala Harris, on peut dire que son incapacité à marquer une différence, son manque de charisme et son échec à se libérer de l’ombre de Biden expliquent en grande partie sa défaite. Ce qui avait commencé comme un projet libéral avec Harris s’est finalement terminé comme une crise pour le Parti démocrate. Si la triste fin de Harris devait apporter quelque chose de positif aux démocrates et à l’Amérique, ce serait l’opportunité de se remettre en question. Cependant, en regardant leurs problèmes structurels et le fait que beaucoup de ce que l’approche libérale considère comme de la politique n’est souvent qu’une critique de la politique, il est difficile de trouver des raisons d’espérer. En réalité, les républicains traversent une crise similaire. Cependant, malgré des difficultés presque identiques, ils ont remporté les élections en surmontant à peine leur problème de leadership grâce à Trump.
Cependant, loin de résoudre le problème de leadership avec Trump, le Parti républicain a vu toute sa structure traditionnelle et son axe entrer dans le chaos. Le choix de Trump d’entourer sa candidature de personnalités comme Vance, un opportuniste assumé et politiquement bipolaire, montre que les républicains ne sont pas en mesure de faire face à leurs crises à court terme. À ce stade, gravir les échelons du leadership au sein du Parti républicain semble impliquer de se « trumpiser » et, si possible, de surpasser Trump. Vance est apparu comme le premier exemple de cette tendance. Inspiré par Obama, prêt à changer de religion pour gravir les échelons sociaux avec une ambition dévorante issue d’une petite ville, Vance a bénéficié de l’attention du New York Times, qui, en faisant de lui une référence littéraire digne de Tocqueville, a propulsé son ouvrage sur les racines sociales de la crise économique de 2008 dans les listes des best-sellers. Ancien critique de Trump sous pseudonyme, il a été repéré par les républicains comme un atout pour briser le « mur bleu » des démocrates grâce à ses origines locales. Désormais, voir émerger de nouveaux « Vance » pour légitimer Trump ne serait guère surprenant.
En effet, si en 2016, Trump a été perçu par les Américains et le monde comme une « erreur » ou un « accident », les années ont démontré qu’il n’était ni une anomalie passagère, ni une exception produite par un système électoral américain déformé. Trump est plutôt apparu comme le produit structurel, durable et authentique de l’imaginaire collectif et de la crise politique américaine. En 2024, il a remporté l’élection en transcendant le système bicentenaire qui, considérant les électeurs comme imprévisibles, permet l’élection d’un président par les États plutôt que directement par les citoyens. En d’autres termes, il a réussi à la fois au niveau du vote populaire et des résultats par État. Son adversaire, Kamala Harris, n’a surpassé Trump dans quasiment aucune circonscription par rapport à 2020. Cela illustre clairement que les Américains rejettent désormais le Parti démocrate, qui s’est transformé en principal représentant d’un monde façonné par les entreprises, les élites libérales, le lobby israélien et l’univers identitaire artificiel promu par Netflix.
La situation désespérée dans laquelle s’est enfoncé le Parti démocrate, alliée à son fanatisme libéral, a conduit à rendre acceptable une figure comme Trump. Perçu par le sud et le centre des États-Unis comme un Nordiste hédoniste et déviant, Trump a néanmoins su s’attirer le soutien de divers groupes sociaux, des musulmans du Michigan aux chrétiens fervents des zones rurales, en passant par les Latinos et les Afro-Américains. Dans un pays où la population non blanche devrait devenir majoritaire d’ici dix ans, l’époque où l’on se demandait en 2008 si les républicains pourraient encore remporter une élection a rapidement laissé place à des questions sur la manière dont le Parti démocrate pourrait se reconstruire. Bien que le Parti républicain semble plus visionnaire, sincère ou distant des débats identitaires que les démocrates, cela ne suffira pas à résoudre ses propres problèmes. Car tout comme le Parti démocrate, vidé de sa substance et contrôlé par des groupes d’intérêts marginaux, le Parti républicain n’est plus le « Grand ancien parti » conservateur d’antan.
L’univers trumpiste entraînera des crises de gouvernance majeures, des impasses politiques et peut-être même des fractures dans les failles sociales américaines. Mais le point le plus important reste le coût que cela pourrait imposer au reste du monde.
Le néo-nationalisme américain, incarné et fédéré par Trump, est très éloigné du conservatisme traditionnel américain. Ce fossé, particulièrement marqué, trouve son origine dans la fonction attribuée aux valeurs. Alors que le conservatisme américain s’est construit à la fois à partir de sa nature missionnaire et de débats philosophiques approfondis, la représentation politique qui se dégage de Trump renonce à la fois aux valeurs et aux approches universelles.
Le Parti républicain traditionnel s’appuyait sur une vision politique, sociale et mondiale cohérente et solidement établie au fil des décennies. Cette vision, forgée par des raisons géographiques, historiques et économiques spécifiques aux États-Unis, s’articulait autour d’une « exceptionnalité américaine » découlant du « combat entre la morale biblique et la nouvelle morale ». Or, cette exceptionnalité est désormais abrogée par l’approche “America First” du monde de Trump, une approche réactualisée dans sa campagne sous le slogan “America Only”.
Deuxièmement, la théologie politique sérieuse et centrée sur Dieu, façonnée par l’éthique puritaine, n’a plus sa place dans ce nouvel univers nationaliste américain. À l’inverse, une « sainte conspiration », portée par l’évangélisme devenu un mélange hétéroclite de croyances et de mythologies, a pris racine en tant qu’acteur majeur. Une autre dynamique notable est l’Atlantisme républicain, un courant politique unique dans l’imaginaire sociopolitique américain, distinct de l’expérience européenne. Ce courant a également donné naissance au libéralisme américain, une idéologie différente du libéralisme européen. Ce libéralisme et l’Atlantisme ont longtemps cohabité au sein du conservatisme américain. Or, le nationalisme actuel, qui en est l’antithèse, s’enferme dans un isolationnisme pur et dur.
Tous ces éléments font écho aux « maux » de l’Amérique, décrits avec une grande clarté par George W. Bush. Dans un discours, il déclarait :
« Dans l’histoire américaine, certains “ismes” apparaissent périodiquement. L’un d’eux est l’isolationnisme. Son jumeau maléfique est le protectionnisme. Et encore plus maléfique est le nativisme. Regardez les années 1920 : la politique “America First” disait “Peu importe l’Europe”. Pourtant, ce qui se passait en Europe était crucial : la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Sur le plan économique, il y a eu la loi tarifaire Smoot-Hawley, qui signifiait simplement que nous ne voulions pas de commerce international. Les barrières douanières ont été érigées. Ensuite, il y avait la politique migratoire : on disait qu’il y avait trop de Juifs, trop d’Italiens. Certains disaient même : “Plus aucun immigrant”. Ce que j’essaie de vous dire, c’est que nous avons déjà vu ces périodes d’isolationnisme, de protectionnisme et de nativisme. Ce qui me fait peur, c’est que nous les revivions. »
Les éléments évoqués dans ce discours visionnaire de Bush constituent aujourd’hui les trois piliers des politiques annoncées par le candidat victorieux des dernières élections. Cela accroît le risque de fragiliser davantage un ordre mondial déjà vacillant, qui traverse l’une de ses périodes les plus faibles des 30 à 40 dernières années. Si l’on devait concrétiser ce risque, il suffirait de rappeler, comme le souligne Bush, que la dernière montée de ces “ismes” à une échelle mondiale a conduit à certaines des guerres les plus dévastatrices de l’histoire de l’humanité.
Le coût mondial des élections:
Les transformations en cours dans la vie politique américaine et le capitalisme américain auront inévitablement des répercussions globales dans les années à venir. Dire que le monde est prêt à affronter ces changements serait exagéré. Tout d’abord, les guerres commerciales, qui sont devenues manifestes depuis 7 à 8 ans et se sont intensifiées sous l’administration Biden, pourraient bouleverser profondément l’équilibre politico-économique mondial. Une telle situation chaotique, dans une époque où presque tout le monde s’est habitué – et dans une large mesure est devenu dépendant – aux avantages du capitalisme globalisé, ne produira pas les mêmes coûts politico-économiques que ceux observés avant l’instauration du commerce libre ou des barrières douanières modérées au Xxe siècle. Au contraire, les interruptions ou les blocages dans les réseaux interconnectés de production, d’offre et de demande impliquant des millions de biens et de services pourraient engendrer des inégalités, des risques de sécurité et des tensions géopolitiques dont il est difficile d’anticiper les conséquences. Les processus d’intégration dans un réseau ne produisent pas la même énergie négative que son effondrement ou le départ de ce réseau.
Trump semble déterminé à ériger de nouvelles barrières douanières. Si cela devait provoquer une nouvelle vague d’inflation, nous ne savons pas exactement quelles en seraient les conséquences mondiales. Ce que nous savons, en revanche, c’est que de nombreuses ruptures dans l’histoire politique mondiale ont également coïncidé avec des “révolutions des prix”, c’est-à-dire des périodes marquées par une inflation significative. Cependant, dans le cadre de sa stratégie de “repousser la Chine”, les États-Unis semblent vouloir imposer au reste du monde un choix brutal et irréaliste : “soit avec moi, soit avec l’ennemi”. Ils s’attendent à ce que de nombreux pays mettent rapidement fin à leurs relations, de quelque nature qu’elles soient, avec la Chine.
La stratégie des États-Unis dans cette guerre commerciale vise clairement à transformer l’ordre économique mondial en une structure bipolaire, une sorte de monde G-2. Dans un tel monde, les autres pays se retrouveraient presque exclusivement coincés entre les États-Unis et la Chine, avec une marge de manœuvre limitée dans ce système économique et politique fermé. Bien que cela présente des défis pour la Turquie, cela pourrait également offrir des opportunités importantes. En effet, l’Europe perçoit désormais les États-Unis comme une autre Chine. Les deux grandes puissances économiques mondiales ont pour l’Europe la même signification économique que pour le reste du monde. En outre, dans un scénario où les États-Unis continueraient de se “siniser”, l’Europe serait contrainte de prendre certaines décisions existentielles.
À cette croisée des chemins politico-économiques et géopolitiques, il est inévitable que des opportunités se présentent pour la Turquie. Tandis que la Chine voit la Turquie comme “une autre Chine”, proche et même intégrée à l’Europe avec sa capacité de production et sa population importante, l’Europe, de son côté, pourrait trouver avantageux de redéfinir ses relations avec Ankara. Cela serait particulièrement pertinent dans un contexte où elle doit faire face aux effets collatéraux de la rivalité sino-américaine, tout en subissant directement les pressions des États-Unis. Washington, qui utilise désormais l’OTAN comme un instrument de pression, cherche à augmenter de manière significative le “coût d’abonnement” du service de sécurité qu’il offre. Parallèlement, il s’oppose déjà à l’Europe dans le cadre de ces guerres commerciales. Pour alléger cette pression, il serait dans l’intérêt de l’Europe de construire un agenda positif avec Ankara, visant une nouvelle perspective en matière de sécurité.
Les incertitudes concernant la mise en œuvre des politiques mentionnées par Trump – si tant est qu’il parvienne à former une administration, ce qui reste un sujet en suspens étant donné qu’au cours de son mandat 2016-2020, il a licencié ou vu démissionner la quasi-totalité des membres de son cabinet et de ses hauts responsables. Il convient également de noter que dans les guerres commerciales, Trump bénéficie de l’expérience accumulée par la bureaucratie américaine, un domaine où Biden lui-même a laissé un héritage notable. Les véritables incertitudes résident dans les domaines géopolitiques et sécuritaires, qui restent souvent limités à des discours rhétoriques sous Trump.
Quelles seront ses relations avec Israël ? Recrutera-t-il, comme en 2017, des personnalités ouvertement iranophobes ? Quelle sera sa politique en Syrie ? Maintiendra-t-il les tensions sécuritaires avec la Chine ? Comment traitera-t-il la situation en Ukraine, qui semble actuellement incapable de vaincre et tente de résister à Moscou ? De quelle manière instrumentaliserait-il l’OTAN dans ses relations avec l’Europe ? Quels choix fera-t-il en Syrie ? Résoudra-t-il les dossiers problématiques mais solvables avec la Turquie ? Et enfin, retirera-t-il les forces américaines présentes en Irak ? Ces questions restent largement sans réponse.
À ce stade, toute spéculation sur ses actions futures dans ces domaines n’a que peu de sens. De même, il est difficile de tirer des conclusions significatives du premier mandat turbulent de Trump. En tant que personnalité singulière et atypique, il est raisonnable de supposer que ses convictions personnelles et son fanatisme continueront d’être ses principales forces motrices.
Il semble improbable que Trump s’accorde avec l’establishment américain, qui est devenu au fil des ans une bureaucratie largement dominée par les démocrates. Quant à la composition de son équipe, de nombreuses informations spéculatives circulent déjà et devraient se multiplier.
Cependant, une seule chose semble certaine : la crise politique américaine continuera de s’aggraver. Les États-Unis oscilleront probablement pendant un certain temps entre deux scénarios : avoir un président incontrôlable dans un pays instable ou un président ayant tiré des leçons des huit dernières années. La direction que prendra cette oscillation reste à voir.